Petite histoire de la guerre contre les drogues
– Par Claude Marcil et Sarah Poulin-Chartrand

En 2012, personne n’a célébré le centenaire de la guerre contre les drogues. Ni les Américains qui l’ont déclenché officiellement en décembre 1914, ni les pays qui, veut veut pas, ont suivi son exemple.
Tous s’attendaient à une brève escarmouche. Or, après des décennies d’efforts, la lutte continue, toujours plus âpre. Environ 2,3 millions d’Américains s’injectent des drogues, de la cocaïne à la métamphétamine (speed) en passant par l’héroïne et des opiacés comme la Dilaudid, l’OxyContin ou le Fentanyl. Au Canada ils sont 325 000; au Québec, quelque 23 000 dont la moitié à Montréal.
Depuis un siècle, les fournisseurs et le marché ont changé. Ainsi, le Québec importe encore l’héroïne et la cocaïne, mais il produit assez de marijuana, d’amphétamines, de drogues de synthèse pour fournir toute la province et exporter le reste. La plupart des pays étaient prêts à continuer la lutte aux côtés des Américains encore quelques siècles même s’ils ne croient plus à la victoire finale. Ils n’ont pas pu; les ravages du sida, la violence des cartels de la drogue, les profits du crime organisé leur ont sorti la tête du sable.
Depuis, ils cherchent des solutions.
Au commencement était la douleur
Pendant des millénaires et des millénaires, l’être humain est resté complètement, totalement impuissants face à la douleur.
Du mal de tête à la jambe cassée en passant par l’accouchement et le coup d’épée dans le ventre, on ne peut compter que sur les herbes médicinales et les incantations des prêtres du coin. Bref, on ne peut qu’endurer sa douleur.
mal de tête à la jambe cassée en passant par l’accouchement et le coup d’épée dans le ventre, on ne peut compter que sur les herbes médicinales et les incantations des prêtres du coin. Bref, on ne peut qu’endurer sa douleur.
Puis, il y a 5 000 ans, dans la plaine entre le Tigre et l’Euphrate (Irak actuel), des Sumériens incisent la capsule verte d’une plante, le pavot. S’écoulent alors des gouttes d’un blanc laiteux qui sèchent en 24 heures.
Les Sumériens constatent avec la plus grande gratitude que ces gouttes soulagent les douleurs, petites ou grandes. À leur suite, les Babyloniens, les Assyriens, les Hébreux et les Égyptiens emploient l’opium avec enthousiasme. Il faut quelques milliers d’années avant que les Grecs, toujours aussi observateurs, en révèlent un aspect inconnu.
Le poète Homère, dans l’Odyssée, invoque un étrange breuvage, « qui fait oublier la douleur», mais aussi «dissipe les chagrins, apaise la colère». Les Grecs sont les premiers à découvrir que ce suc du pavot n’est pas seulement un anti-douleur, il permet aussi de se détacher des anxiétés de l’existence. Et même qu’on s’y habitue.
Au cours des années, les Grecs s’alarment en constatant que des malades deviennent dépendants de ce remède, le réclamant de plus en plus souvent.
Mais c’est toujours le seul médicament capable de calmer la douleur, et aussi bien Hippocrate, le père de la médecine occidentale, que Gallien, qui sera la grande autorité médicale pendant 1 000 ans, recommandent ce remède qu’on appelle maintenant de son nom latin, l’opium.
Dans la Rome impériale de 312, plus de 800 boutiques vendent de l’opium, dont le prix, modique, est fixé par décret de l’empereur…
 L’empereur Marc-Aurèle
L’empereur Marc-Aurèle
Bien connu pour son détachement des choses en général et de la douleur en particulier, l’empereur Marc-Aurèle est le premier opiomane connu en Occident, et d’ailleurs l’un des derniers pendant longtemps. En effet, à la suite de la chute de l’empire romain, le remède est oublié. On ne le retrouve plus que dans les recettes de sorcières et les souvenirs des Croisés revenus de la Terre Sainte.
La médecine arabe prend la relève et s’en sert abondamment. Vers l’an mille, des commerçants arabes l’introduisent en Chine, qui l’adopte aussitôt; c’est le remède souverain contre la dysenterie. En Chine comme partout ailleurs, l’opium est avalé, bu ou mâché.
Puis, en 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique.
À cause de Colomb
Chistophe Colomb, entre autres produits exotiques, ramène en Espagne le tabac qui fait aussitôt fureur en Europe. Peu après, les Espagnols l’introduisent aux Philippines. En quelques décennies, les grands navigateurs espagnols, portugais et hollandais propagent le tabac un peu partout en Extrême-Orient.
Vers 1620, des Hollandais établis dans l’île de Taïwan, en face de la Chine, ont l’idée de mélanger l’opium et le tabac. L’opium brut ne pouvant se fumer pur car il carbonise, les Chinois deviennent très habiles pour fabriquer le « chandoo », un opium purifié semi liquide, qu’on fume dans une pipe spéciale. Le client prend l’habitude de s’étendre pour le fumer parce qu’il tombe rapidement endormi après sa pipe.
L’opium génère trafic et corruption au point que les empereurs interdisent sa consommation. Aucun effet. En 1792, l’empereur décide de s’attaquer à la source et interdit son importation. Ce qui pose un sérieux problème aux Britanniques, qui ont découvert le thé et ne peuvent plus s’en passer.
Au grand désespoir du gouvernement britannique, aucun, mais alors là aucun de leurs produits n’intéresse l’empereur. Ils doivent payer le thé, ainsi que la soie, en lingots d’argent. Aussi, leur balance commerciale avec la Chine est désespérément dans le rouge.
Les Britanniques pensent alors à vendre aux Chinois l’opium qui pousse dans leurs possessions des Indes. Pour contourner l’interdiction de l’empereur, ils (plus précisément la East India Company) achètent les fonctionnaires du port de Canton (Guangzhou) au sud de la Chine, le seul ouvert aux étrangers.
À partir des années 1830, les Britanniques font entrer massivement l’opium en Chine à partir de Canton; mille tonnes durant la seule année 1838. Les livres commencent à balancer.
En 1839, humilliation suprême, l’empereur supplie la reine Victoria de faire cesser ce trafic. Le parlement britannique s’y oppose et juge inopportun «d’abandonner une source de revenus aussi importants.»
La première « guerre de l’opium »
Le 28 mars 1839, les autorités de Canton s’emparent de 20 000 caisses d’opium venues de l’Inde et les jettent à la mer. L’Angleterre réclame aussitôt le versement d’une indemnité. Refus.
Les Britanniques envoient une flotte de guerre; six navires débarquent 7 000 hommes qui s’emparent de Shanghaï. Puis, les navires bombardent les villes de la côte jusqu’à ce que les Chinois signent un traité de paix en 1842; l’empereur doit non seulement rembourser l’opium saisi aux Britanniques mais aussi leur céder l’île de Hong-Kong.
En 1856, les autorités chinoises arraisonnent le navire Arrow, et un nouveau conflit éclate. Encore une fois, les Britanniques écrasent les Chinois mais avec un coup de main de quelques pays européens et des États-Unis. Deux ans plus tard, un autre traité particulièrement dur: la Chine doit laisser les Britanniques commercer l’opium dans dix ports dont Hong kong. Et l’opium est désormais légalisé en Chine. Finalement, les missionnaires chrétiens, surtout américains, pourront sillonner la Chine comme bon leur semble. Ils seront les premiers à constater sur place les ravages de l’opium.

A busy stacking room in the opium factory in Patna, India
After W S Sherwill, lithograph, c.1850
La Révolution industrielle
La révolution industrielle bat alors son plein en Europe, en Australie et en Amérique. Pour creuser des canaux, construire des chemins de fer ou travailler dans les mines, elle a un besoin massif de travailleurs.
Pour la première fois de la longue histoire de la Chine, des dizaines de milliers de ses habitants changent de continent. Ils apportent l’opium avec eux. En 1850, le consul britannique de la ville de Canton observe qu’ils sont regroupés dans des enclos comme du bétail; sur leur dos, on a peint les lettres P, S, ou C selon leur destination: Pérou, Îles Sandwich, Californie.
En Californie, ils travaillent d’abord à extraire de l’or. Au milieu du siècle, on veut relier l’Atlantique au Pacifique par un chemin de fer. La Central Pacific a un besoin urgent de 5 000 travailleurs. Mais on ne pense pas aux Chinois pour un travail dur comme percer les Montagnes rocheuses et poser des rails de fer; ils sont trop délicats, leurs mains sont trop petites, ils ne sont pas grands.
Lorsque Charles Crocker, principal sous-contracteur de Central Pacific, propose d’engager des Chinois, le boss lui répond:
-Qu’est ce que les Chinois connaissent à la construction?
-Ils ont construit le mur de Chine!
Durant la seule année 1852, 30 000 Chinois quittent Hong Kong pour San Francisco.


Ils sont d’abord exploités, avant leur départ, par les intermédiaires qui leur ont trouvé du travail en Amérique; puis par les capitaines de navires; finalement par les compagnies américaines qui les paient une fraction du salaire des Blancs pour un travail abrutissant et dangereux à cause des explosifs.
Une seule consolation: leur pipe d’opium qui soulage la douleur, la fièvre, la diarrhée, éteint le désir sexuel et la nostalgie du pays…
Les mines épuisées, les chemins de fer terminés (1885 au Canada) les Chinois n’ont pas l’argent pour retourner chez eux. Dans les Chinatown de San Francisco et de Vancouver, ils ouvrent des buanderies, des restaurants, des fumeries d’opium (la première à Vancouver en 1870). Mais surtout, ils acceptent n’importe quel travail. Les syndicats les accusent d’un péché mortel: ils travaillent trop fort pour trop peu d’argent. Lorsqu’une dépression économique frappe l’Amérique en 1875, le racisme éclate ouvertement.

1881: Americains dans une fumerie d’opium de New York (Harper’s Weekly)
Les journaux découvrent soudainement la menace de l’opium. Ils racontent à pleines pages que des Chinois diaboliques utilisent l’opium pour détruire la volonté de jeunes filles aussi blanches que vierges afin de les faire travailler comme prostituées. On les croit. La Californie, qui accueille la plus forte communauté chinoise, adopte la première loi contre l’opium, celui des Chinois, celui qui se fume. D’autres États emboîtent le pas; en 1892, l’opium est interdit dans la plupart des États de l’Ouest américain. Il est permis au Canada, mais en 1885, une enquête fédérale sur l’immigration chinoise précise que fumer de l’opium est « une habitude païenne incompatible avec le mode de vie d’une nation chrétienne. »
Les Chinois ne comprennent pas l’acharnement des Américains contre l’opium, encore moins celui des Canadiens membres de cet empire britannique qui, justement, leur a enfoncé l’opium dans les bronches. D’ailleurs, ils voient les Blancs prendre de l’opium à Vancouver comme à San Francisco et ailleurs. C’est vrai, mais les Blancs ne fument pas l’opium. L’opium est dans des flacons. Les Blancs ont suivi une voie différente des Chinois pour devenir dépendants de l’opium.
Une drogue tout usage
Quelque peu oublié pendant le Moyen Age, l’opium avait été redécouvert par le médecin Paracelse, le grand marginal du 16ième siècle. En mélangeant opium, eau, et quelques autres ingrédients, Paracelse avait créé un breuvage, le laudanum (« qu’on doit louer »).
C’est un second début pour l’opium qui, en plus de calmer la douleur, devient le remède souverain contre la grippe et la dysenterie. Comme on avait oublié depuis longtemps les avertissements des Grecs sur les dangers d’accoutumance, les médecins prescrivent allégrement le laudanum pour calmer l’ulcère déchirant l’estomac du cardinal de Richelieu ou les calculs rénaux de Benjamin Franklin. Si on utilise beaucoup d’autres remèdes, on leur ajoute presque toujours de l’opium, toujours le seul qui réussit à calmer la douleur. L’opium prend différentes formes au cours des années; laudanum, boulettes ou pilules vendues en pharmacies. Puis, au début du 19ième siècle, des chimistes commencent à extraire les éléments actifs de différentes plantes.
Vers 1803, date clé dans l’histoire de la drogue, un chimiste allemand, Friedrich Serturner, réussit à extraire un des deux ingrédients actifs naturels de l’opium (l’autre est la codéine, beaucoup moins puissante). S’inspirant de Morphée, la déesse grecque du sommeil, Serturner lui donne le nom de morphine.
Après quelques dangereuses expériences sur ses voisins qui risquent de prolonger indûment leur sommeil, le chimiste abandonne ses recherches. Trop tard, la médecine s’empare du produit, car la morphine apaise les douleurs encore plus rapidement que l’opium. En 1827, la compagnie allemande E. Merck débute sa fabrication industrielle. Comme l’opium, on la vend en liquide ou en pilule, mais ce n’est pas l’idéal; le soulagement n’est pas rapide. Puis, en 1853, le médecin écossais Alexander Wood et le chirurgien français Charles Gabriel Pravaz – ce dernier inspiré par le pulvérisateur de son jardinier- inventent simultanément la façon parfaite de d’administrer la morphine; la seringue avec une pointe assez fine pour percer la peau et une veine. Avec la seringue, la morphine soulage quasi immédiatement la douleur, les doses peuvent être mesurées précisément et ses effets, analysés.
Wood en injecte à sa femme qui souffre de douleurs névritiques. Effet calmant immédiat. Répétitions. Elle devient la première morphinomane.
La « maladie du soldat »
«God’s Own Medicine», comme on dira, est utilisée massivement pour la première fois aux États-Unis lors de la guerre de Sécession. Sur les champs de bataille, le soldat apprécie une injection de morphine après avoir reçu une balle quelque part et avant qu’on lui coupe une jambe ou un bras. Après cinq années de guerre, 45 000 soldats morphinomanes retournent chez eux, et ils n’ont aucune difficulté à s’approvisionner pour traiter ce qu’on appelle la «maladie du soldat.»
Il est aussi facile de se procurer de l’opium dans l’Amérique du 19ième siècle que de l’aspirine dans celle d’aujourd’hui. Les médecins prescrivent ou vendent directement aux patients souffrant de douleurs chroniques, opium ou morphine. À la campagne, où vit la majorité de la population, les médecins laissent le flacon et la seringue en indiquant au patient qu’il peut en prendre quand la douleur revient. Les pharmaciens en vendent aussi avec ou sans prescription de même que les magasins généraux et les bureaux de tabac. Sans compter les vendeurs itinérants d’élixirs miracles. On peut même commander ce qu’on veut par la poste.
On crée ainsi des toxicomanes à la pelle. Il n’y a tout simplement pas d’autre remède à la douleur. L’écrivain Alphonse Daudet, qui éprouvait des douleurs fulgurantes dans la moelle épinière à cause de sa syphilis, a évoqué dans La Doulou l’intense soulagement d’une piqûre de morphine.
Utiliser l’opium ou la morphine quand on n’est pas souffrant n’est pas considéré comme respectable. Pour certains, c’est même immoral. C’est un vice comme le jeu, l’alcool ou la cigarette. Mais absolument personne ne voit ce vice comme une menace à la société.

Opium den in the East End of London
After Doré, Illustrated London News, 1874
Dans cette trousse de médicaments on trouve la morphine et le laudanum, qui est un vin à base d’opium.
Les premiers doutes
Pendant ces décennies de prescriptions irréfléchies, des médecins s’inquiètent. Ils voient bien que beaucoup de leurs confrères sont devenus morphinomanes et que lorsqu’un patient n’a plus ses injections, le sevrage cause des réactions physiques douloureuses, comme celles de l’alcoolique privé d’alcool. Vers la fin des années 1890, de plus en plus de médecins, comme d’ailleurs leurs patients commencent sérieusement à se méfier de la dépendance physique à la morphine. Puis l’industrie pharmaceutique trouve une solution.
Lors de son long séjour en Amérique du Sud au XVIII siècle, le botaniste Joseph de Jussieu avait constaté que les indiens des Andes mâchaient les feuilles d’une plante, la coca, un stimulant herbal du cœur, plus énergique que le café et sans effets secondaires. Il avait ramené des plants en France en 1750 et les avait ajouté à l’herbier du Muséum d’histoire naturelle. Pendant un siècle, personne ne s’y intéressa. De temps en temps, un voyageur envoyait quelques plants mal emballés en Europe mais les éléments actifs de la coca avaient le temps de s’abîmer au cours du long et lent voyage à travers les forêts tropicales et l’océan Atlantique.
En 1857, à la demande de Friedrich Wöhler, chef du laboratoire de chimie de l’université Göttingen, l’explorateur Karl von Scherzer en ramène une quinzaine de kilos spécialement enveloppés. Wöhler confie à l’un de ses brillants et prometteurs étudiants, Albert Niemann, la tâche d’analyser les plantes et de trouver ce qui les rend stimulantes.
Quelques semaines de travail acharné plus tard, le jeune chercheur réussit à isoler parmi la douzaine d’éléments actifs de la plante, celui qui stimule et le nomme cocaïne.
La même année, le médecin et explorateur Paolo Mantegazza publie à son retour de l’Amérique du Sud l’ouvrage Sur les propriétés hygiéniques et médicinales de la coca et sur l’alimentation nerveuse en général. Il note, enthousiaste: « I would rather have a life span of ten years with coca than one of 10 000 000 000 000 000 000 000 centuries without coca. »
Après avoir lu l’ouvrage de Mantegazza, les amateurs de sensations nouvelles se mettent à mâcher des feuilles. Les joueurs du Toronto Lacrosse Club, pionniers parmi les sportifs, utilisent ce produit dopant. Mais le spectacle de ces mâles virils en train de mâcher vigoureusement des feuilles avant de les cracher tout aussi vigoureusement, n’encourage personne à les imiter.
 En 1863, un jeune chimiste corse, Angelo Mariani, a l’idée de macérer des feuilles de coca dans un vin de Bordeaux sucré qu’il appelle Vin Tonique Mariani à la Coca du Pérou. Génie du marketing, il envoie gratuitement des échantillons de son vin (chaque once de vin contient 7,2 mg de cocaïne; une ligne de coke = 150 mg) aux médecins, leur suggérant de l’essayer pour les maux de gorge. Il en envoie aussi aux prêtres, aux politiciens, aux vedettes, affirmant que son vin combat la faiblesse, la fatigue et stimule les convalescents.
En 1863, un jeune chimiste corse, Angelo Mariani, a l’idée de macérer des feuilles de coca dans un vin de Bordeaux sucré qu’il appelle Vin Tonique Mariani à la Coca du Pérou. Génie du marketing, il envoie gratuitement des échantillons de son vin (chaque once de vin contient 7,2 mg de cocaïne; une ligne de coke = 150 mg) aux médecins, leur suggérant de l’essayer pour les maux de gorge. Il en envoie aussi aux prêtres, aux politiciens, aux vedettes, affirmant que son vin combat la faiblesse, la fatigue et stimule les convalescents.
Il sollicite aussi leurs commentaires. Délirant! Il reçoit des centaines de témoignages qui vont du pape Léon XIII ( qui lui remet une médaille pour le remercier) au président des États-Unis et au tsar de Russie, en passant par Thomas Edison, Émile Zola, Jules Verne, etc. 3 000 médecins endossent son produit. Les ventes explosent.
Mariani ouvre des bureaux à Londres, New-York et Montréal. Le vin Mariani devient le remède le plus prescrit au monde. Il faut préciser qu’à ce moment, le seul stimulant disponible en Occident est le café…
Devant ce succès, des pharmaciens et des chimistes commencent à créer non pas du vin, mais des toniques qui contiennent eux aussi de petites quantités d’extraits de la plante, un peu comme les espressos et les boissons énergisantes d’aujourd’hui.
Parmi eux, John Pemberton, un pharmacien d’Atlanta, crée en 1886 un Peruvian Wine Cola, macéré avec des feuilles de coca, auquel il ajoute des noix de kola, riches en caféine. « Une boisson délicieuse pour le palais et très rafraîchissante », mais aussi, dit-il, « souveraine contre le mal de tête, l’hystérie, la mélancolie, etc. » La même année, Atlanta prohibe la vente de l’alcool. Pemberton enlève aussitôt le vin, garde les extraits de coca et de cola et remplace l’eau plate par du soda; le nouveau breuvage s’appelle Coca-Cola.

Il n’y a alors dans le monde que quelques usines pharmaceutiques capables d’extraire la cocaïne des feuilles, parmi lesquelles Merck en Allemagne, avec sa propre plantation de coca au Pérou et, depuis 1884, la Parke Davis à Détroit. La demande explosant, la compagnie demande à Henry Hurd Rusby, médecin et botaniste, de ramener de Bolivie une cargaison massive de feuilles de coca et, si possible, de trouver une méthode pour extraire la cocaïne sur place, ce qui règlerait les problèmes du transport.

En décembre 1884, Rusby ramasse quelque 200 000 livres de feuilles de coca. La plupart sont gâtées durant le long voyage de retour vers Détroit. Mais il trouve une façon d’extraire une pâte à partir de la plante. 100 kilos de feuilles = un kilo de pâte. Cette pâte, pasta basica, une fois filtrée et séchée, contient de 40% à 65% de cocaïne. Rusby peut ensuite expédier ce concentré sans problème à Détroit.
Parke-Davis (maintenant une branche de Pfizer) lance une campagne de publicité: la cocaïne est souveraine pour les coliques, les maux de dos, etc. Pour encourager les médecins à prescrire la cocaïne à leurs patients, la compagnie leur envoie gratuitement un bulletin, la Therapeutic Gazette. Parmi les lecteurs, un jeune médecin de Vienne, Sigmund Freud.
L’apôtre de la cocaïne

Âgé de 28 ans, Freud désespère d’épouser Martha Bernays, sa fiancée depuis trois ans. Il rêve d’une grande découverte scientifique qui assurerait son avenir financier et donc son mariage avec Martha.
En 1884, il lit le rapport de Theodore Aschenbrandt, un médecin militaire allemand. Ce dernier a acheté de la cocaïne pure à la compagnie Merck et l’a donnée aux soldats avant leurs manoeuvres dans les montagnes de Bavière. Freud lit qu’en dépit de l’ascension harassante, du mauvais temps et du froid, les soldats conservent une énergie étonnante. Freud est aussitôt enthousiasmé.
Il croit avoir trouvé le produit miracle, celui qui va le rendre célèbre et lui permettre de se marier. Il commande un premier gramme de cocaïne à Merck et en avale une petite quantité (vraisemblablement une dose de 50 mg environ). Peu après, il est pris d’un accès de gaieté et éprouve un sentiment de légèreté. Ses doigts et ses lèvres lui donnent une sensation cotonneuse, puis de chaleur, et surviennent ensuite des bâillements suivis d’une certaine lassitude.
Freud se rend compte que la cocaïne engourdit la langue et les muqueuses. Il en parle à son collègue, l’ophtalmologiste Karl Koller.
Il renouvelle l’expérience; il ressent un sentiment d’assurance, de force accrue et peut se livrer à un travail intellectuel prolongé sans éprouver la moindre fatigue.
Son « vibrant pladoyer » de quelque 10 000 mots en faveur de la cocaïne paraît sous le titre Uber Coca (À propos de la coca) dans le numéro de juillet 1884 d’une revue médicale, la Centralblatt für die Gesamte Therapie. Il y résume les connaissances de l’époque sur la coca et le résultat de ses observations. Selon Freud, la cocaïne est le premier médicament capable de stimuler les centres nerveux et il la recommande pour traiter les mélancolies, les hypochondries et les dyspepsies. Freud émet aussi l’hypothèse que la cocaïne aide à guérir de la morphine; il donne sept références qui toutes proviennent de la Therapeutic Gazette.
Grand bruit dans le monde médical.
Pendant ce temps, son ami Köller fait quelques expériences avec la cocaïne.
Il en donne un peu à un collègue qui lui signale qu’elle lui engourdit la langue, ce à quoi Köller répond : « Oui, tous ceux qui en ont pris ont fait la même remarque. » Il écrit qu’à ce moment, il a « subitement réalisé » qu’il avait dans sa poche l’anesthésique local, sans seringue.
Une révolution médicale

Koller répète l’expérience.
Les chirugiens de l’oeil ont souvent besoin de tester les réactions de leur patient à la lumière ou d’ajuster l’angle de leur tête sur la table d’opération.
« (…) Ces contraintes rendaient les opérations de l’oeil particulièrement dangereuses et délicates, car (…) la douleur induite par une opération à l’oeil sans anesthésie est difficilement imaginable. (P.153, David Cohen, Freud sous coke, Balland)
11 septembre 1884. Koller se prépare à opérer un patient souffrant de glaucome. Il verse des gouttes d’un mélange d’eau et de cocaïne sur les yeux du patient. Lors de l’opération, le patient ne ressent aucune douleur. Succès historique qui fait le tour du monde. C’est une véritable révolution de la médecine, le point de départ de la chirurgie oculaire moderne (cataractes), mais aussi d’autres chirugies, dentaire, etc.
Évidemment, on exagère aussitôt. On utilise la cocaïne pour traiter la tuberculose, le cancer, la « nervosité », la neurasthénie, etc. La cocaïne apparaît même, pour la première fois, dans un roman, A Travel in Bohemia (1886) écrit par un ophtalmologiste, sir Arthur Conan Doyle. Le personnage principal, Sherlock Holmes, adore s’injecter de la cocaïne.
.
Cocaine Toothache Drops, c.1900s
.
Le catalogue de la compagnie Sears-Roebuck offre, pour 1,50$, un kit de cocaïne de Parke-Davis avec sa propre seringue hypodermique.

Puis le doute.

Freud prescrit de la cocaïne à un de ses professeurs morphinomanes, Ernst von Fleischl-Marxow, afin de traiter sa dépendance. Fleisch finit par s’en injecter un gramme par jour. Pure. C’est un échec retentissant que Freud n’a jamais voulu reconnaître; mais il ne touche plus à la cocaïne.
En mai 1886, Albrecht Erlenmeyer, un spécialiste de la dépendance à la morphine, accuse Freud d’avoir lâché le « troisième fléau de l’humanité », après l’opium et l’alcool. Un an plus tard, le British Medical Journal explique que « la réaction indéniable contre les qualités extravagantes prêtées à ce remède l’emporte déjà.» Freud réagit en juillet par un article qui défend passionnément la cocaïne. On s’engueule pendant des années. Puis, la compagnie pharmaceutique allemande Bayer annonce qu’elle a enfin trouvé la solution à la dépendance à la morphine.
La solution: l’héroïne
Heinrich Dreser, responsable du laboratoire de la compagnie Bayer, a testé une nouvelle drogue sur des animaux et des humains (dont lui même). Il est stupéfait de son efficacité contre la toux. Intéressant! Les maladies respiratoires douloureuses comme la pneumonie et la tuberculose empêchent de dormir et sont alors les principales causes de mortalité.
En 1898, lors d’un congrès de médecins allemands, il présente officiellement cette drogue efficace qui non seulement ne crée pas de dépendance, mais en plus soulage les symptômes de sevrage des opiomanes et des morphinomanes. Bayer, s’inspirant du mot allemand, «heroisch», (efficace, héroïque) enregistre ce nouveau médicament miracle sous le nom de « Héroïne ».
Bayer lance une grande campagne de marketing et envoie des échantillons aux médecins. Des essais cliniques font son éloge; à dose égale, l’héroïne est trois à quatre fois plus puissante que la morphine. Rapidement, les médecins la prescrivent à la place de la morphine ou de la codéine. Une année après sa mise en marché, Bayer exporte de l’héroïne dans 23 pays.
Quelques médecins s’inquiètent; ils observent que les symptômes de sevrage de l’héroïne sont pires que ceux de la morphine. Peu d’échos. Plus tard, l’American Medical Association fait une mise en garde à l’égard de l’héroïne. Rien n’y fait. L’héroïne s’ajoute aux quantités massives de morphine et de cocaïne qui sortent des usines pour être vendues partout dans le monde en toute légalité et, sauf dans quelques pays, sans le moindre contrôle.
En 1900, plus de 600 médicaments contiennent de l’opium, de la morphine, etc. Les journaux sont remplis d’annonces de remèdes miracles contre la toux, les douleurs menstruelles, les problèmes de la ménopause, de sirops calmants pour les bébés qui pleurent, la malaria, la syphilis, l’insomnie; en somme, tout ce qui est douloureux. Le résultat est toujours le même : guéri ou non, le malade se sent mieux …pour un temps.
Les fabricants d’élixirs, de breuvages toniques ou de médicaments ne sont pas obligés d’indiquer quoi que ce soit sur les étiquettes. Certains l’indiquent fièrement, d’autres non.

Toutes ces drogues étant légales, les prix sont très bas. La cocaïne -pure- qui se vendait quelques centaines de dollars l’once en 1884, coûte maintenant 0,25$ le gramme en 1900). Avec de tels prix, aucun marché noir et aucune criminalité.
Selon l’historien David Courtwright (Dark Paradise : Opiate Addiction in America before 1940), qui a beaucoup étudié cette période, au tournant du siècle, environ 330 000 Américains (sur une population de 76 millions) prenaient à l’occasion de l’opium ou de la morphine. Il y a une bonne minorité de médecins (entre 6% et 23%), mais en majorité ce sont des femmes dans la quarantaine, de la classe moyenne et qui prennent ces drogues à la demande de leurs médecins.
Tout change à cause de deux journalistes
Deux journalistes jettent alors quelques pelletées de sable dans les rouages bien huilés de la florissante industrie pharmaceutique.
Premier coup de semonce : en avril 1905, Collier’s Weekly publie un article d’Upton Sinclair, Is Chicago Meat Clean? C’est à vomir. Il décrit les immenses abattoirs de Chicago avec des détails horribles : la saleté repoussante des abattoirs, les rongeurs empoisonnés par la mort-au-rat, puis écrasés par les machines, transformés en saucisses. Les ventes de viande chutent de moitié.
Le 7 octobre, dans la même revue, Samuel Hopkins Adams écrit le premier d’une série de 11 articles, The Great American Fraud. Il a demandé à des chimistes d’analyser des échantillons des médicaments les plus populaires. Les lecteurs sont révulsés. Par exemple, le médicament populaire Hostetter’s Stomach Bitter contient 44.3% d’alcool (pour mettre le tout en perspective, une bière contient de 4 à 7 % d’alcool, le vin de 10 à 15%). Plusieurs médicaments contiennent de l’opium, de la morphine, de l’héroïne, etc. Lorsque le dernier article paraît, Adams a exposé 264 compagnies et individus, et identifié des dizaines de personnes décédées à cause de ces drogues. 500 000 Américains ont lu ses articles.
Pure Food & Drug Act
Affolé, le Congrès adopte en quelques mois à peine le Pure Food and Drug Act. Washington surveille désormais les produits alimentaires et, malgré la résistance farouche des fabricants de remèdes, les oblige à indiquer sur les étiquettes de leurs produits s’ils contiennent de l’opium ou ses dérivés, de la cocaïne, du cannabis ou de l’alcool.
La lecture des étiquettes effraie les Américains. Les ventes de médicaments contenant des drogues plongent et les fabricants de breuvages toniques se dépêchent d’enlever toute trace de drogue de leurs produits. Coca-Cola, par exemple, garde le nom « coca », mais élimine la moindre trace de cocaïne des feuilles de coca qu’elle fait venir du Pérou. Seules les couleurs du drapeau péruvien (rouge et blanc) sur les canettes rappellent cette époque.
Le croisé de McGill
Depuis des années, les missionnaires américains en Chine lançaient des cris d’alarme devant les ravages de l’opium et demandaient au State Department (l’équivalent d’un ministère des affaires étrangères) de faire pression sur la Grande-Bretagne pour qu’elle cesse de vendre de l’opium indien en Chine. On estime que vers 1906, 27% des Chinois fument de l’opium. «China achieved a level of mass addiction never equaled by any nation before or since. »
Un oeil sur les malheurs de la Chine, l’autre sur son immense marché, le State Department suggère au président Theodore Roosevelt d’organiser une rencontre internationale sur l’opium. C’est accepté. L’International Opium Commission aura lieu à Shangaï.
Parmi la délégation américaine se trouve le jeune ambitieux Hamilton Wright, un ancien étudiant de McGill, et l’homme responsable, à lui seul, de la déclaration de guerre à la drogue.
Avant son départ, Wright visite les principales villes américaines, envoie des questionnaires aux chefs de police, aux médecins, aux compagnies pharmaceutiques. Lorsqu’il embarque à bord du Siberia pour Shangaï, ce fanatique est convaincu que le problème de l’opium est pire aux États-Unis qu’en Chine.
À Shangaï, il fait la connaissance d’un autre croisé, canadien celui-là, qui vient tout juste d’interdire l’opium dans tout le Canada. C’est vrai qu’il avait été aidé par une émeute anti-chinoise à Vancouver.
Le péril jaune
Depuis que le chemin de fer est terminé, les syndicats et les groupes sociaux de la Colombie-Britannique trouvent qu’il y a trop de Chinois dans la province. Pratiquement chaque jour, à la une du Vancouver Province, des caricatures racistes avertissent que la province va être engloutie par les Chinois. Les affrontements sanglants entre travailleurs chinois et blancs sont réguliers.
Pour limiter l’immigration, Ottawa a imposé une taxe de 50$ à chaque Chinois qui vient travailler au Canada. La taxe passe à 100$ en 1902, puis à 500$ en 1904, une somme colossale à l’époque.
Le 7 septembre 1907, un vaste mouvement social, l’Asiatic Exclusion League, appuyé par les chambres de commerce et par les députés conservateurs, organise une manifestation à Vancouver. On veut, on exige, la fin de l’immigration asiatique. Plus de 10 000 personnes, soit 10% de la population, s’assemblent devant l’Hôtel de ville où les politiciens, les leaders syndicaux et religieux les chauffent à blanc. Les discours à peine terminés, des milliers d’enragés envahissent les quartiers chinois et japonais. Pendant cinq heures, ils battent tous les Asiatiques qu’ils rencontrent et vandalisent les commerces.
Le Premier ministre Wilfrid Laurier veut compenser les pertes des commerçants. Il envoie à Vancouver dès octobre le sous-ministre du Travail, le jeune Mackenzie King, pour examiner les réclamations des commerçants asiatiques. Parmi ces derniers, deux propriétaires de manufactures d’opium. King tombe des nues.
Il les visite. On y tranforme l’opium brut en gomme pour les pipes. La province en compte cinq autres, toutes parfaitement légales. Deux sont en opération depuis vingt ans.
Aidé par Peter Hing, un étudiant de l’Université McGill qui pilote la Chinese Anti-Opium League de Vancouver fondée deux ans plus tôt, King prépare son « Rapport sur la nécessité de supprimer le commerce de l’opium au Canada ». Son indignation suinte dans chacune des 33 pages du rapport qu’il soumet durant l’été à Rodolphe Lemieux, le ministre du Travail.
« […] l’habitude de fumer de l’opium fait des progrès parmi les garçons de race blanche mais aussi parmi les femmes et les jeunes filles.» (William L. Mackenzie King, Ottawa, Document parlementaire 36b, 1908, pp 7-8.)
Quelques jours plus tard, le parlement adopte, sans débat, la Loi sur l’opium. Il est interdit d’importer ou de vendre de l’opium, sauf pour des raisons médicales, et ne vise donc que l’opium fumé par les Chinois. Les Blancs peuvent acheter leur opium, leur morphine, leur héroïne sous forme de remèdes ou d’élixirs, chez le pharmacien ou l’épicier.
La même année, Ottawa passe une loi sur l’étiquetage largement inspirée du Pure Food & Drug act américain.
Devenu l’expert canadien de l’opium, King est nommé à la délégation britannique qui va participer à la réunion de Shangaï.
À la dernière minute, les Américains réalisent qu’aucune loi fédérale n’interdit l’importation de l’opium. Un peu gênant… En s’inspirant largement de la loi canadienne, comme l’écrit fièrement King dans son journal intime, ils passent rapidement une loi contre l’importation d’opium.
Le 4 janvier 1909, Hamilton Wright annonce aux congressistes de treize pays qu’avec la nouvelle loi: « Une nouvelle ère vient de commencer aux États-Unis.» Il a malheureusement raison.
La Commission de Shanghai
Les joueurs-clés de la drogue sont presque tous à Shanghai en 1909: les gros manufacturiers comme les Allemands et les Japonais, puis les pays qui ont des colonies où pousse le pavot comme la France ( Indochine), l’Angleterre (Inde) etc. Pour la première fois, des pays veulent bien reconnaître que la lutte contre la drogue exige une coopération internationale, mais ils ne veulent pas une coupe à blanc dans leurs revenus. Aussi, les délégués adoptent des résolutions aussi intéressantes que non-contraignantes qu’ils soumettront à leurs gouvernements respectifs: mettre fin graduellement à l’habitude de fumer de l’opium dans leurs colonies et interdire l’usage de l’opium et ses dérivés (morphine, héroïne, etc.) sauf pour les besoins de la médecine. La plupart n’ont pas l’intention de pousser dans le dos de leur gouvernement. Deux exceptions, l’Américain Hamilton Wright et le Canadien Mackenzie King.
Ce dernier est efficace; en 1911, Ottawa adopte une nouvelle mouture de sa Loi canadienne sur l’opium. Il était interdit de trafiquer de l’opium, il est maintenant interdit d’en fumer. La loi interdit également la morphine, sauf pour des raisons médicales et ajoute la cocaïne à la demande de groupes sociaux montréalais qui affirment qu’elle est un problème majeur chez les jeunes. Enfin, on durcit la loi: la peine maximale pour trafic passe de trois ans à sept ans de pénitencier.
Pendant ce temps, Wright se déchaîne, cajole le Congrès, fait du lobbying, tout pour sensibiliser le pays au problème de la drogue. Il déclare même au New York Times en 1911: « Uncle Sam is the worst drug Fiend in the world » ou « The Opium and Morphine habits have become a national Curse ».
En fait, il est dans l’erreur. La situation a beaucoup changé en une dizaine d’années.
Grâce aux découvertes de Pasteur, les médecins connaissent maintenant le rôle des microbes dans les maladies; ils ont poussé les gouvernements à s’occuper de l’eau potable et à construire des égoûts. Aussi, il y a beaucoup moins de diarrhées et de dysenteries autrefois soignées uniquement avec l’opium.
Les étiquettes des remèdes indiquant maintenant le contenu, les médecins réfléchissent beaucoup avant de prescrire des drogues, les patients aussi avant de les accepter. Lorsqu’il lance Le Devoir en 1910, Henri Bourassa précise que le journal refusera toute publicité pour « les mauvais livres, les boissons fortes autres que vins et bières, les médecines brevetées à base d’opium, de morphine, de cocaïne ou d’alcool (…) »
(Mario Cardinal, Pourquoi j’ai fondé Le Devoir: Henri Bourassa et son temps. P.102)
Enfin, facteur crucial, Bayer a mis sur le marché en 1899, « Aspirin », un remède sans danger, qui remplace efficacement l’opium ou la morphine pour les douleurs légères. Bref l’épidémie est sous contrôle; les toxicomanes sont beaucoup moins nombreux qu’auparavant. Mais ils ont changé.
La petite minorité qui prenait de la drogue non pour calmer une douleur mais pour le plaisir est maintenant plus nombreuse: ce sont surtout des jeunes, parfois membres de gangs, toujours délinquants. Dans pratiquement chaque cas, un des membres a essayé une drogue et d’autres l’ont imité.
La sympathie envers les femmes blanches âgées, victimes de leurs médecins, ne s’étend pas à ces jeunes toxicomanes qui font aussi peur qu’horreur. D’autant plus qu’un mouvement d’activistes puritains, qui savent mieux que les Américains ce qui est bon pour eux, prend de plus en plus d’importance. Ils s’opposent aux vices: le jeu, la drogue et surtout l’alcool.
Une deuxième conférence
Hamilton Wright a quand même convaincu ses supérieurs de faire un suivi de la conférence de Shangaï. En décembre 1911, quarante-six pays sont présents à La Haye en Hollande. Malgré les pressions de Wright, ils signent un texte vague à souhait qu’ils devront proposer à leurs gouvernements: « Les puissances signataires s’efforceront…» de contrôler l’opium, ses dérivés, et la cocaïne.
Wright, qui veut faire des États-Unis le leader mondial de la guerre contre la drogue, continue à pousser Washington à voter une loi –fédérale- sur la drogue qui s’appliquerait donc partout aux États-Unis. Avec sa propre police pour la faire respecter.
Un os, le dixième amendement de la Constitution: « Les compétences non explicitement accordées au gouvernement fédéral sont du ressort des États. »
Depuis qu’ils ont perdu la Guerre de Sécession, les États du Sud ont érigé un système leur permettant de garder les Noirs sous leur contrôle. Cette nouvelle loi fédérale, avec sa propre police dirigée par Washington, serait une sérieuse brèche dans le mur protégeant les droits des États. Et Dieu sait ce que le fédéral pourrait faire ensuite…
Wright l’admet: «C’est un travail difficile… la Constitution est toujours dans le chemin.»
Puis, il a une inspiration. La Cour Suprême vient de décréter que le fédéral a le droit de réglementer tout ce qu’il taxe.
Taxer la drogue?
Wright réfléchit: il serait peut-être possible de faire voter une loi sur les narcotiques en la déguisant sous une loi fiscale. Mais toujours l’écueil des États du Sud. Avec son égo démesuré, une absence de scrupules pour manipuler les chiffres, l’énergie et la subtilité d’un bulldozer, Wright joue à fond la carte raciale.
Il a déjà déclaré en 1910:« Cocaine is often the direct incentive to the crime of rape by the negroes. » En fait, les Noirs n’en prennent pas plus que les autres, mais les Sudistes ne demandent qu’à le croire, d’autant plus qu’ils sont déjà convaincus que sous l’effet de la cocaïne, les Noirs sont pratiquement invincibles. Ainsi, les policiers du Sud ont déjà exigé et obtenu qu’on remplace leur calibre 32 par le calibre 38. Une loi interdisant la cocaïne ne poserait pas d’obstacles.
Il reste un dernier obstacle : que faire avec toutes ces personnes de bonnes moeurs devenues droguées à cause de leur médecin? On cesse de s’angoisser sur ces victimes innocentes parce que l’homme d’affaires Charles B. Towns a trouvé un remède infaillible. Avec sa formule secrète, un peu de discipline, et une longue fin de semaine, cinq jours max, il désintoxe n’importe qui. Garanti!
Il place des annonces dans les journaux offrant aux toxicomanes une guérison rapide. Aucune réponse. Finalement, un drogué se porte volontaire. Avec un ami, Towns l’enferme dans une chambre d’hôtel et lui administre sa formule secrète, un laxatif puissant… Pendant deux jours, le volontaire essaie de s’évader puis de se suicider. Après quoi, raconte Towns, on lui a offert de la drogue. Il a refusé, preuve que la cure est efficace…
L’histoire du laxatif se répand : aucun nouveau volontaire. Qu’à cela ne tienne. Towns et son ami kidnappent un autre drogué. Cinq jours d’enfer. Guérison!
Puis, il convainc Alexander Lambert, professeur à l’École de médecine de l’Université Cornell et médecin personnel du Président Theodore Roosevelt, de tester la cure sur ses patients de l’hôpital Bellevue. Todds procède; ça semble marcher. Lambert est impressionné. Tout le monde parle de la cure et de son taux de réussite qui tourne autour de 90%. Les rares qui demandent des détails se font répondre par Towns que: « Les toxicomanes dont il n’entend plus parler ont forcément été guéris. »
Bref, soulagement général. On ne laissera pas en plan des dizaine de milliers de toxicomanes.
L’obstacle est levé. Après quinze ans d’efforts, les croisés l’emportent. Ironie de l’histoire, Wright n’est plus là pour triompher. Il a perdu son poste pour cause d’alcoolisme.
En décembre 1914, les États-Unis adoptent la loi Harrison ( du nom du politicien qui propose la loi) après de longues discussions; certains voulaient interdire la caféine au passage et les États du Sud ont exigé et obtenu que la cocaïne soit inclue dans la loi.
Manufacturiers, médecins, pharmaciens, tous ceux qui fabriquent, achètent ou vendent des drogues (opium, morphine, héroïne et cocaïne), devront obtenir un permis du Bureau du Trésor (Bureau of International Revenue) qui surveillera leurs activités et les taxera. Bref, le tout est présenté comme une mesure fiscale qui va rapporter au gouvernement.
Aux médecins et aux pharmaciens, on explique que cette modeste opération protégera les patients. La preuve: désormais, eux seuls auront le droit de prescrire ou de vendre ces drogues « dans l’exercice de leur profession », et « à des fins médicales légitimes ». Rien pour inquiéter les médecins.
On s’attend à une brève escarmouche. La plus longue guerre de l’histoire américaine commence.
Avec une touchante naïveté qui force l’admiration, ces croisés contre la drogue, comme ceux contre l’alcool, sont convaincus que les Américains vont simplement obéir à la loi. En fait, une autre loi s’applique aussitôt, celle de l’offre et de la demande.
Au début, les toxicomanes de New York qui n’ont pas accès à un médecin pour une raison ou pour une autre, vivotent en revendant de la ferraille dans les industrial dumps, d’où l’étiquette junkies. Puis, ils s’approvisionnent au nouveau et balbutiant marché noir.
Cinq ans après la loi Harrison, le Trésor s’est organisé. Il a formé en décembre 1919 le Bureau des Narcotiques, qui regroupe des agents zélés. Ces derniers se penchent sur la loi, particulièrement sur la section touchant les « fins médicales légitimes ».
Dompter les médecins
Selon les agents des Narcotiques, c’est très simple: un toxicomane peut arrêter de prendre de la drogue s’il le veut bien. La dépendance aux drogues -et à l’alcool-, n’est pas une maladie, mais un vice. Aussi, les médecins ne peuvent donc pas en prescrire pour « des fins médicales légitimes ».
Beaucoup de médecins refusent cette interprétation étroite et vont devant les tribunaux. La cause se rend en Cour suprême; les agents des Narcotiques avaient prévu le coup depuis longtemps.
Après avoir tamisé leurs dossiers pendant plusieurs mois, ils avaient trouvé le cas parfait: le médecin Webb, un charlatan qui vendait pour 50 cents des prescriptions à ses milliers de patients sans jamais les examiner. Son record: 4 000 doses d’héroïne et de cocaïne à un seul patient. Le génie des agents des Narcotiques est de donner à la Cour suprême l’impression que ce comportement est routinier chez les médecins qui traitent des toxicomanes.
En 1919, la Cour suprême interdit aux médecins de prescrire des drogues à leurs patients, quels qu’ils soient: des vieilles dames aux médecins en passant par les soldats de la Grande guerre devenus morphinomanes après de longs séjours à l’hôpital. Ils ne peuvent pas se tourner vers la méthode de Towns car le médecin Lambert, inquiet du taux de rechute, a finalement eu l’idée de vérifier scientifiquement ses résultats fabuleux. Catastrophe! Les données ont été truquées.
Dans une première étape, les agents fédéraux des Narcotiques mettent la pression sur les médecins.
Ceux qui continuent à prescrire des narcotiques à leurs malades sont harcelés, ruinés ou jetés en prison. En 1921, 1 500 pharmaciens et médecins sont condamnés par les tribunaux.
Puis, ils s’attaquent aux cliniques de désintoxication opérées par des municipalités qui doivent fermer les unes après les autres.
La dernière à résister est celle du médecin Willis P. Butler de Shreveport en Louisiane, qui a l’appui du conseil municipal. Au début 1923, le procureur général de l’État s’en mêle. La clinique est fermée
Butler dira plus tard qu’il a été obligé d’abandonner une centaine de patients incurables. Un bon nombre s’est retrouvé en prison ou au pénitencier; certains sont morts, d’autres ont rapidement atteint « a condition of wretched poverty » parce qu’ils ont été obligés de se tourner vers le marché noir maintenant florissant.
La nouvelle pègre internationale
Trois ans après la fermeture de la clinique de Shreveport, S.L. Rakusin, un inspecteur des Narcotiques, declare que l’héroïne semble plus répandue qu’elle ne l’a jamais été. Pas surprenant, le dessus du panier de la pègre, aux États-Unis, au Canada et en Europe, s’est lancé dans le trafic international de drogues.
Petite histoire de la Mafia et du crime organisé en Amérique
.
L’homme qui a inspiré l’écrivain F. Scott Fitzgerald pour le personnage de Meyer Wolfshiem dans « Gatsby le Magnifique ».
Arnold Rothstein, le père du crime organisé, avait envoyé des hommes en Europe pour acheter de l’alcool. Ils lui apprennent que rien n’est plus facile que d’y acheter des narcotiques. Les compagnies pharmaceutiques en France, en Allemagne, ou en Hollande sont prêtes à vendre de grandes quatités d’héroïne, de morphine ou de cocaïne sans poser de questions.
Couper à la source
Le problème est que depuis les conférences de Shangaï et de La Haye, les gouvernements européens ont soigneusement évité de passer des lois pour contrôler les compagnies pharmaceutiques. Dans les colonies françaises, britanniques, hollandaises, la vente d’opium ou de cannabis est un monopole d’état. Au Maroc par exemple, la France a créé la Régie du kif (mélange de marijuana et de tabac) administrée jusqu’en 1952 par la très respectable Banque de Paris et des Pays-Bas, plus connue aujourd’hui sous le nom de Paribas.
La Grande guerre a justifié en partie le retard. Celle-ci terminée, les Américains ont obligé tous les signataires du traité de paix de Versailles à appliquer leurs engagements de 1912 lors de la réunion de La Haye. En gros : contrôler le trafic international. Pour surveiller le tout, on se fie à Interpol, la nouvelle police qui fait le lien entre les différents corps policiers du monde, et à la nouvelle Société des Nations (SDN), l’ancêtre de l’ONU.
Ensuite, lors de International Opium Conference à Genève, en 1924, les gros producteurs de drogue, Grande-Bretagne, France, Inde, Chine, etc., acceptent de compiler des statistiques qui permettront de connaître la production mondiale et les besoins de la médecine en drogues, ce qui permettra de contrôler qui fabrique, qui vend et en quelle quantité les drogues interdites.
En attendant les statistiques…
Le marché noir
Entre juin 1925 et juin 1926, la douane américaine confisque 449 livres d’opium, 42 livres de morphine, 3,5 livres d’héroïne et 10 livres de cocaïne. Pour l’année fiscale 1927-1928, les chiffres grimpent à 2 354 livres d’opium, 91 de morphine, 27 d’héroïne, et 30 de cocaine. Ce ne sont que les quantités saisies. Durant la seule année 1926, Rothstein finance l’importation de deux tonnes de narcotiques.
Rapidement, des liens se tissent entre les trafiquants de Montréal et ceux de New York. En 1919, la GRC avait crié victoire lorsqu’elle avait saisi 180 livres d’opium au domicile de Lee Jee sur la rue La Gauchetière. En 1924, elle saisit 3 000 livres de morphine, d’héroïne et de cocaïne sur la rue Saint-Pierre.
À partir des années 20, Montréal est la plaque tournante pour l’opium, l’héroïne et la morphine venus d’Europe. La ville est un port important, terminus des grandes lignes de chemin de fer et se trouve près de la frontière. Et, ce qui ne gâche rien, une ville corrompue avec un Red Light connue de tous les criminels au nord du Rio Grande.
Les pressions des grands trafiquants, comme l’Américain Rothstein, les frères Georges et Élias Eliopoulos en Europe, le Montréalais Harry Davis qui sera condamné en 1930 pour trafic de 852 kilos de narcotiques, changent les moeurs des toxicomanes.
Plus de profits, moins de risques
Pendant la Prohibition, les fournisseurs préfèrent de beaucoup vendre du whisky, du gin ou d’autres boissons plus ou moins frelatées que de la bière. Plus d’alcool, moins de volume. Les traficants de drogues arrivent à la même conclusion.
Rapidement, ils offrent, au lieu de l’opium, de la morphine puis de l’héroïne à leurs clients américains et canadiens. Traditionnellement, l’héroïne était fumée; les toxicomanes réalisent vite qu’il est beaucoup plus économique et efficace de s’injecter l’héroïne d’abord sous la peau puis directement dans une veine. Arrêtés, clients et vendeurs sont aussitôts envoyés en prison
L’arsenal législatif
En 1923, la moitié des 1 482 détenus du pénitencier fédéral de Leavenworth ont été condamnés pour infraction à la loi Harrison. À la surprise du Bureau des Narcotiques, ils persistent dans leur vice.
Ausitôt libérés, ils retournent illico à l’héroïne. Explication des experts déçus: ils n’ont pas été en prison assez longtemps. Il faut durcir la loi comme les Canadiens viennent de le faire.
En 1922, le député conservateur de Vancouver South, H.H. Stevens, a ameuté les Canadiens: des trafiquants distribuaient de la drogue aux enfants d’école. Indignation monstre! Lourdes pressions sur les politiciens. Un an plus tard, le Parlement amende la loi de 1911. En plus de l’opium, la morphine et l’héroïne sont maintenant interdites.
C’est maintenant un crime de se trouver dans un endroit où il y a des narcotiques. La Loi renverse le fardeau de la preuve, c’est à l’accusé de prouver qu’il ne le savait pas.
La Loi annule aussi une autre garantie juridique fondamentale : le droit d’appel. Par ailleurs, les juges peuvent aussi condamner au fouet et déporter tout étranger (lire: Chinois) reconnu coupable de trafic ou de possession. La même année, non seulement on ferme à double tour les frontières du Canada aux Chinois, mais tous les Canadiens d’origine chinoise, nés ici ou non, doivent s’enregistrer auprès du gouvernement.
Finalement, le ministre de la Santé, Henri-Séverin Béland, annonce au comité qui étudie la loi: « Il y a un nouveau narcotique dans la liste. » C’est le cannabis, ajouté là à cause d’une féministe engagée. Le Canada devient un des premiers pays du monde à interdire de fumer la marijuana, placée dans la même catégorie que les narcotiques.
Emily Murphy est la mère de la prohibition du cannabis au Canada. Exploit d’autant plus remarquable qu’il n’y avait pas un seul joint au pays.
Ottawa a enlevé Emily Murphy des billets de 50 dollars, mais n’a pas encore osé déboulonner sa statue devant l’édifice du Parlement canadien. Après tout, elle a été en 1916 la première femme nommée juge (à Edmonton) de tout l’Empire britannique. Mais c’est vrai qu’Emily Murphy est gênante.
Sous le pseudonyme de Janey Canuck, la juge publie dans le Maclean’s cinq articles expliquant que les femmes blanches qui utilisent des drogues sont tellement détériorées moralement et physiquement qu’elles couchent avec des Noirs et des Asiatiques, posant ainsi une sérieuse menace à la race blanche. « [Il] existe parmi les étrangers de couleur de la propagande bien définie visant à entraîner la dégénérescence de la race blanche. ».
Dans de nombreux passages, elle met en garde contre « les Assyriens (Arabes), les Nègres et les Grecs alliés aux Chinois dans le trafic de drogue ». La consommation de haschisch, totalement inconnue au Canada -comme d’ailleurs la marijuana- entraîne un « comportement d’excitation maniaque, pouvant parfois se prolonger en un délire se terminant par l’épuisement et même la mort ».
En 1922, pour atteindre un public plus large et pousser ainsi dans le dos du fédéral, elle regroupe ses articles dans le livre « Black Candle » (La chandelle noire), qui a un succès monstre. Lorsque, un an plus tard, sans débat, Ottawa ajoute la marijuana aux drogues interdites, il n’y a toujours pas un seul joint au Canada.
«Black Candle»: Pour lire le livre au complet
Re-mouture de la loi en 1929, qui donne aux policiers le droit d’entrer, sans mandat, n’importe quand, n’importe où, « s’ils ont un doute raisonnable » qu’ils vont y découvrir des drogues.
La question de la drogue est un des rares domaines où les politiciens canadiens refusent totalement de se laisser influencer par les pratiques britanniques.
En Grande-Bretagne, les autorités de la santé avaient, depuis 1868, enlevé l’opium et la morphine des épiceries et des marchands pour les réserver seulement aux médecins et aux pharmaciens.
Suite aux pressions des Américains, la Grande-Bretagne avait demandé à Henry Rollerston, président du Royal College of Physicians de faire le point sur la question des drogues. Le rapport de son comité en 1926 est aux antipodes des Américains et des Canadiens.
Il écarte comme des mouches les législateurs qui essaient de se placer entre un médecin et son patient, même toxicomane. D’ailleurs pour le comité, ce dernier n’est pas un criminel, mais un malade. En toute logique c’est donc aux médecins et non aux policiers de s’en occuper.
Le comité conclut que les médecins peuvent administer des stupéfiants sur une base régulière « lorsque le patient, capable de mener une vie utile et relativement normale quand on lui administre régulièrement une certaine dose minimale, en devient incapable quand la drogue est interrompue ».
Pas de sevrage, pas de marché noir, tout se passe entre le patient et son médecin. Ce rapport, le socle de l’approche britannique face aux toxicomanes, va fonctionner jusqu’aux années 70. Ensuite, les Britanniques vont copier les Américains….

Les premières statistiques mondiales sont dévoilées en 1931. Malaise général! La médecine a besoin de 350 tonnes de drogues par année; les compagnies pharmaceutiques en produisent plus de 8000 tonnes. Ainsi, les besoins médicaux de la Suisse sont de 18 livres d’héroïne par année; elle en manufacture 6 620. Le surplus, 6 602 livres, elle l’exporte.
La plupart des pays acceptent de fixer la quantité maximale de stupéfiants qu’ils vont fabriquer ou importer; les Japonais refusent. Pour eux, la drogue est une arme et pas seulement économique. Ils le prouvent lorsqu’ils s’emparent de la Mandchourie en 1931, et la transforment aussitôt en narco-état, le premier de l’histoire. Lorsqu’ils envahissent la Chine, ils organisent l’intoxication massive du pays pour miner la résistance.
Pour les agents des Narcotiques, le marché noir une fois tari, les toxicomanes seront bien obligés d’arrêter. Erreur.
Coupés des stocks légaux, les trafiquants internationaux se lancent dans la fabrication. C’est alors que débute l’ère des grands chimistes de la pègre et celle d’Henry Anslinger, le nouveau chef du tout nouveau Bureau Fédéral des Narcotiques (FBN), créé en 1930.
L’ère des chimistes clandestins
Ex-agent du Bureau de la Prohibition, Harry Anslinger est un puritain brutal, énergique et sans scrupule. En poste jusqu’à 1962, il sera le papa de plusieurs tactiques qui seront copiées plus tard par son grand rival, le FBI: surveillance téléphonique sans mandat, réseaux d’informateurs payés, agents doubles, impunités pour les criminels qui témoignent contre leurs complices.
Son pouvoir est immense. Lui, et lui seul, peut décider qui a le droit de vendre aux États-Unis des anti-douleurs contenant des narcotiques, ce qui revient à dire à peu près tout sauf l’aspirine. Anslinger sait qu’il est plus facile de surveiller un petit groupe de gros fabricants qu’une flopée de petits. En 1936, il n’a admis dans ce cartel restreint que huit compagnies dont Merck, Hoffman La Roche, Eli Lilly et Squibb.
Les membres du cartel lui en sont éternellement reconnaissants. À chaque fois qu’il aura besoin d’eux pour faire accepter une loi, ils se précipiteront pour l’appuyer devant le Congrès; quand il sera attaqué, ils tordront discrètement des bras. Anslinger devient intouchable.
Sa première tâche est de répondre aux plaintes stridentes des directeurs de pénitenciers.
The Narcotic Farm

Les toxicomanes, surtout des ouvriers blancs, représentent le tiers des détenus des pénitenciers fédéraux.
Or, dans les pénitenciers comme dans les prisons d’État, les directeurs en ont ras le bol des détenus toxicomanes, ces « pommes pourries » qui complotent à l’année longue pour faire entrer de la drogue. Les directeurs craignent la « contamination » des autres détenus.
Washington décide de regrouper toutes les pommes pourries – et quelques volontaires- au même endroit. Le 29 mai 1935, les premiers patients-détenus arrivent à Lexington dans un paysage bucolique du Kentucky. Un hôpital-prison de 1 500 lits surnommé « Narcotic Farm » les attend. Il y en aura un deuxième à Fort Worth, Texas.
La mission de la « Narcotic Farm » est de sevrer les toxicomanes, les réhabiliter et trouver un remède à leur dépendance. Deux ans plus tard arrivent les premiers condamnés qui n’ont jamais vu une seringue de leur vie; ils ont fumé ou vendu de la marijuana.
Au Canada, la marjuana était interdite depuis 1923. Première arrestation en 1937.
The Narcotic Farm – Documentaire (55.18)
.
L’herbe qui rend fou
La marijuana était arrivée aux États-Unis grâce aux travailleurs de l’Inde que la Grande-Bretagne avait fait venir dans les Caraïbes pour remplacer les Noirs après l’abolition de l’esclavage. La plante s’est répandue au Mexique et dans différentes îles dont la Jamaïque et, de là, à la Nouvelle-Orléans. Plus tard, des Mexicains fuyant la révolution des années 1910 ont traversé la frontière américaine et se sont établis dans les États du Sud-Ouest : Nouveau-Mexique, Texas, Arizona, etc.
La prohibition de l’alcool avait poussé ceux qui cherchaient des sensations, fortes ou non, à essayer autre chose. Ce sera, entre autre, la marijuana.
Et ça recommence : Mexicains + marijuana = danger.
Le procureur de la Nouvelle-Orléans révèle que la marijuana est un stimulant sexuel. Hearst, le magnat de la presse, ordonne à ses 50 quotidiens, à ses magazines et à ses postes de radio de sensibiliser les Américains à l’herbe qui pousse un peu partout et qui rend fou. Des groupes religieux financent Reefer Madness (La folie du joint), un film qui démontre les conséquences horribles d’un premier joint de marijuana: meurtre, suicide, viol et folie.
Reefer Madness (1938)
.
True History of Marijuana (1.17.35)
.
Teen-Aged Dope Slaves
Pourtant, le Public Health Service avait étudié la marijuana et conclut: « le Cannabis ne cause pas de dépendance… il appartient probablement à la même catégorie que l’alcool. » Henry Anslinger ne croit pas non plus au danger de cette herbe qui pousse un peu partout, mais les États du Sud-Ouest lui tordent le bras.
En 1937, lors des audiences sur la Marihuana Tax Act, (remarquons le mot « Tax »), Anslinger horrifie les membres du Congrès avec l’histoire sordide de Victor Licata, un fumeur de marijuana de 21 ans qui a tué à la hache ses parents, ses frères, et sa soeur.
Il explique que, sous l’influence de la marijuana, « des personnes tombent dans une rage délirante et peuvent commettre des crimes violents. »
Anslinger néglige de mentionner que les autorités de la Floride avaient essayé, en vain, d’envoyer le jeune homme dans un asile bien avant son premier joint.
La loi est votée. Le cannabis rejoint l’opium et l’héroïne dans la catégorie des narcotiques. Quiconque vend, achète ou fume de la marijuana doit obligatoirement, sous peine de cinq ans de pénitencier, obtenir un papier avec un timbre officiel. La beauté de la loi est qu’il faut se présenter avec la marijuana pour obtenir le timbre. On est donc déjà en infraction… Autre détail savoureux, le gouvernement n’a pas de papier timbré pour la marijuana et n’a pas l’intention d’en fabriquer. Kafka n’aurait pas fait mieux.
Le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, à l’hôtel Lexington de Denver (Colorado), la police aperçoit Samuel Caldwell, 58 ans, en train de vendre deux joints de marijuana à Moses Baca. Ils sont arrêtés. Le juge Foster Symes déclare alors: « Je considère que la marijuana est le pire des narcotiques, beaucoup plus que la morphine ou la cocaïne. La marijuana détruit la vie elle-même. »
Caldwell est condamné à quatre ans de pénitencier; Baca à 18 mois de prison.
Les speeds
Pendant qu’on cloue la marijuana au pilori, les compagnies pharmaceutiques mettent sur le marché sans l’ombre du début d’une controverse, des dérivés d’un stimulant synthétisé un demi-siècle plus tôt, l’amphétamine.
Ces dérivés, tous des excitants puissants (benzédrine, méthédrine dexedrine, etc.), rapidement surnommés « speeds », excitent le système nerveux, coupent la faim et empêchent le sommeil. Le rêve très éveillé pour les camionneurs au long cours et pour les étudiants pendant leurs examens; pour ceux qui veulent maigrir; pour les athlètes qui veulent un surplus d’énergie. En Suède, en 1938, le speed est moussé par des slogans du style: « Deux petites pilules valent mieux qu’un mois de vacances. »
Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde est étonné par des prouesses qu’on n’avait pas vues pendant la Première Guerre: les soldats allemands qui se battent pendant deux, trois jours, sans jamais s’endormir; les pilotes britanniques toujours aussi vigilants après des dizaines d’heures de vol, sans compter l’enthousiasme délirant des kamikazes japonais.
La raison est simple: tous les belligérants consomment des quantités astronomiques de speeds. En 1940, les troupes allemandes avaient reçu 35 millions de comprimés d’amphétamines pendant les quatre mois de l’offensive d’Hitler à l’Ouest. Après la guerre, le « Times » de Londres titre en première page : « La méthédrine a gagné la bataille d’Angleterre.»
Déboussolés par la défaite fulgurante et le drame d’Hiroshima, des millions de Japonais dont 300 000 habitués passent à travers les énormes stocks militaires en vente libre. C’est la catastrophe! Une épidémie de psychoses et de dépressions. Pendant que les Japonais adoptent des lois d’une sévérité inouïe : amendes énormes, 10 ans de travaux forcés, etc., l’épidémie gagne Guam, les îles Marshall et l’Amérique où les speeds sont en vente libre.
La demande est forte; à la clientèle habituelle (travailleurs, étudiants), s’ajoutent les soldats démobilisés et les excentriques de la Beat Generation, les Beatniks.
La Beat Generation

Jusqu’alors, les groupes qui voulaient améliorer leur sort cherchaient à changer la société. Pas les Beatniks. C’est même l’inverse: ils veulent se changer eux-mêmes et la société suivra éventuellement. Ils sont l’amorce de la bombe culturelle qui va sauter dans les années soixante.
Alors que les jeunes Américains se marient, amorcent le Baby Boom, achètent leur première voiture et fuient la ville pour la banlieue, les premiers beatniks abandonnent l’Université Memorial de Manhattan où ils se sont connus, fument de la marijuana et achètent des speeds à la pharmacie du coin. Le plus connu, Jean-Louis “Jack” Kérouac, né de parents canadiens-français, a écrit le premier jet de « On the Road » en trois semaines grâce à la benzédrine. Kérouac, comme le poète Allen Ginsberg, est fasciné par un autre beatnik, William Burroughs, héroïnomane, vendeur de drogues et futur patient de la Narcotic Farm de Lexington.
Allan Ginsberg déclarera dans son poème classique Howl (hurlement) qu’il avait vu: « les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, nus, hystériques, se traînant à l’aube dans les quartiers des nègres pour trouver leur dose. »
Animation du poème «Howl» de Allen Ginsberg
Par Mark Mantzer
Les mauvais musiciens: les musiciens de jazz…
La guerre a réduit l’héroïne à un filet qui provient surtout du Mexique. Sa pureté chute, les réserves s’épuisent. En 1945, il ne reste que 20 000 héroïnomanes aux États-Unis et le grand chef de la mafia, Lucky Luciano, a été déporté en Italie. Anslinger entretient l’inquiétude des Américains et son budget par quelques arrestations spectaculaires de vedettes, Gene Krupa, Robert Mitchum (marijuana), Errol Flynn (cocaïne), la chanteuse Billy Holiday et le saxophoniste Charlie Parker (héroïne).
En 1948, Anslinger, le chef du Bureau des Narcotique, commet sa première gaffe sérieuse. Il témoigne alors devant un Comité du sénat. « J’ai besoin de plus d’agents » dit-il. Les séanteurs lui demandent pourquoi.
-« Parce qu’il y a des personnes qui violent les lois sur la marijuana. »
-« Qui? »
-« Des musiciens. Je ne veux pas dire les bons musiciens, je veux dire les musiciens de jazz. »
En moins de 24 heures, 76 éditoriaux de journaux le massacrent y compris des éditions spéciales de revues musicales. En trois jours, le Département du Trésor reçoit 15 000 lettres.
Problèmes de personnalités?
C’est un fait que les meilleurs jazz bands du monde sont à Lexington avec des musiciens comme Chet Baker, Sonny Rollins ou Howard McGhee. C’est que la majorité des patients ne sont plus des Blancs, mais des Latinos et des Noirs, reflet des changements majeurs parmi les toxicomanes depuis la fin de la guerre. Ce qui n’est pas sans percer de sérieux trous dans la théorie qui fait alors, à peu près, l’unanimité et que résume bien un Comité de sénateurs canadiens:
« Selon les témoignages des médecins, la toxicomanie (…) est un symptôme d’une faiblesse du caractère et des défauts de la personnalité de la victime. Le toxicomane est d’ordinaire une personne émotivement déséquilibrée et instable à laquelle les stupéfiants donnent du «cran». (Comité spécial du Sénat sur le trafic de stupéfiants au Canada, 1955)
Ce qui voudrait dire que ces problèmes de personnalité ont cessé, collectivement, d’affecter les Blancs pour frapper les Noirs et les Latinos, qui soudainement, ont besoin de « cran ».
Du grand délire!
William Burroughs, qui est justement à Lexington en 1948, a écrit: « There is no pre-addict personality any more than there is a pre-malarial personnality, all the hogwash of psychiatry to the contrary. » L’historien des drogues David T. Courtwright confirme: « There is relatively little in the historial record to contradict Burroughs’ essential insight ».
Les chercheurs de Lexington, les seuls dans le monde à faire des recherches sérieuses sur les drogues, ont quand même balayé quelques mythes qui traînent dans le décor social depuis des décennies et publié les résultats dans des revues spécialisées: il est impossible de reconnaître, à l’oeil, les futurs toxicomanes. Ils ne sont ni malades mentaux ni déficients mentaux. Il est faux aussi, comme l’affirme la GRC, que les toxicomanes se droguent parce qu’is sont déjà criminels et non l’inverse.
Ils sont aussi unanimes sur les conséquences et ne peuvent que confirmer ce qu’écrivait déjà vingt-cinq ans plus tôt le journaliste Albert Londres dans « Frères de la Drogue » :
« La vie du toxicomane n’a plus qu’un but : se procurer la marchandise. Son intérêt, sa profession, ses affections, sa famille, cela le malade le voit encore, mais il marche dessus pour atteindre plus vite un pot de Merck [cocaïne allemande], une petite boîte de Bénarès [opium en argot]. »
Depuis l’ouverture de Lexington, on n’y applique qu’un seul traitement: la désintoxication plus ou moins rapide, toujours douloureuse. ”It wasn’t very pleasant,” dira la psychiatre Marie Nyswander qui y a travaillé en 1945. Quand ils sortent de Lexington ou de son jumeau Forth Worth, aucun suivi, ils sont abandonnés à eux-mêmes. 90% au moins rechutent aussitôt. Les chercheurs n’y comprennent rien.
Un quart de siècle plus tard, la très sérieuse Consumer’s Union écrira:
« L’héroïne est une drogue qui provoque l’accoutumance. C’est celle que la plupart des usagers continuent à prendre même quand ils veulent arrêter. Et ce, même si effectivement ils réussissent à arrêter pendant des mois ou des années. C’est une drogue à laquelle on retourne rapidement après tous les traitements. C’est une drogue que la plupart continuent à prendre même s’ils sont menacés de longues peines d’emprisonnement et à laquelle la plupart retournent après un long emprisonnement. »
(Licit and Illicit Drugs: le rapport intégral)
 The Trafic in Narcotics (1953), Harry J.Anslinger.
The Trafic in Narcotics (1953), Harry J.Anslinger.
Puis, l’armée américaine leur fait un cadeau inespéré.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ne pouvaient plus s’approvisionner en opium. La compagnie I.G. Farben a alors mis au point la méthadone, une copie synthétique de la morphine. À la fin de la guerre, l’armée américaine a fait main basse sur le produit et l’a envoyé aux chercheurs de Lexington. Premiers tests. Résultats prometteurs. En 1948, ils l’essaient avec un échantillon impressionnant de 115 toxicomanes.
Aucun doute, la méthadone supprime les symptomes du sevrage; les patients demandent même s’ils pourraient en trouver une fois libérés. Mais après quelques expériences avec des doses très fortes qui causent des nausées et des dépressions respiratoires, les chercheurs abandonnent la méthadone qui tombe dans l’oubli. Et les rechutes continuent. Pourtant, le Canada songe sérieusement à copier Lexington en envoyant les toxicomanes pendant de longues périodes à la station de quarantaine de William‑Head, dans l’Île-de-Vancouver.
C’est clair pour tous les toxicomanes, Lexington ne fonctionne pas. Mais, en dehors des toxicomanes et des chercheurs, personne n’est au courant de ces échecs. Jusqu’en 1955.
À l’époque, tous les films doivent obtenir le fameux visa de la censure qui applique le tristement célèbre code Hays, Bible du bon censeur. Le code interdit par exemple de voir deux personnages s’embrasser s’ils ne sont pas mariés, ou simplement de prononcer des mots comme enceinte, vierge ou narcotique !
Otto Preminger soumet aux censeurs le script de « L’Homme aux bras d’Or », le premier film réaliste sur les héroïnomanes, adapté d’un roman de Nelson Algren: Frankie, un toxicomane, revient d’une cure de six mois à Lexington décidé à s’abstenir de drogues. Mais il retourne dans son quartier, rencontre les mêmes amis, le même milieu. Il rechute. Les censeurs demandent à Preminger de supprimer les scènes où quelqu’un prend de la drogue et les allusions aux suicides. Par ailleurs, Frankie devra connaîtra la rédemption grâce au courage de son épouse aimante.
Preminger refuse et explique à son studio: « The Man with the Golden Arm est unique et tabou, le public curieux et fatigué par tant de censure va se précipiter dans les salles pour découvrir ce pamphlet libertaire ». Le pari est gagné et à partir de ce moment, le code Hays commence à se déplacer vers les oubliettes.
«L’Homme aux bras d’Or»
.

The Man with the Golden Arm (1955) – Film Complet (1:14:22)
.
https://www.youtube.com/watch?v=o1WWdq-G3EQ
Les Britanniques qui voient le film n’y comprennent rien
Pendant ce temps en Grande-Bretagne
Trente ans après le rapport Rolleston de 1926, la Grande-Bretagne n’a toujours pas de problèmes de drogues. Les médecins les prescrivent à leurs patients qu’ils connaissent bien; 383 toxicomanes sont enrégistrés comme tels auprès de leurs médecins en 1947; à peu près le même nombre dans les années 1950, dont un quart de médecins et pharmaciens. Il n’y a pas de marché noir. Entre 1946 et 1951, on a saisi au pays un grand total de 11 grammes d’héroïne; aux États-Unis, en 1951 seulement, on a saisi 28 870 grammes.
Mais Américains et Canadiens réussissent à ne pas en tenir compte. Sauf un petit groupe de la Colombie-Britannique, le Greater Vancouver Community Chest and Councils, un genre de Centraide.
L’organisme avait été troublé par le nombre de condamnations pour drogues en 1952: 367 au Canada; 24 au Québec, 70 en Ontario et 245 à Vancouver.
Cette année-là, après avoir sérieusement étudié le problème des narcotiques, une première au Canada, l’organisme recommande de mieux informer la population et de créer des cliniques qui fourniraient de l’héroïne aux 2 000 Canadiens qui en prennent régulièrement pour qu’ils puissent fonctionner dans la société. Les éditorialistes de The Province et du Sun endossent ces recommandations. Celui du Sun précise que ce plan « would eliminate the illegal drug trade by destroying its root – the fabulous underworld profit in drugs. »
Trois ans plus tard, en 1955, un Comité de sénateurs canadiens rejette à l’unanimité ce genre de cliniques, soulignant d’ailleurs que la Commission des stupéfiants des Nations-Unies les déconseillait. Bref, pour la réhabilitation, la seule note positive de la décennie est la fondation par deux femmes d’un groupe de Narcotiques Anonymes qui se réunit au Collège Loyola de Montréal.
Depuis le début de la guerre à la drogue, le Canada et les États-Unis ne voient toujours qu’une solution; elle a la simplicité de la laitue: la drogue disparaîtrait toute seule si les sentences étaient plus sévères. Ainsi, le rapport annuel de la GRC en 1947 était limpide: il faut imposer aux toxicomanes récidivistes des peines de plus en plus lourdes, culminant avec l’emprisonnement à vie après un certain nombre d’offenses.
La loi de Boggs
En 1951, Hale Boggs, le Représentant de la Louisiane, pilote, avec l’appui discret d’Anslinger, une loi sévère contre les drogues illégales. Juste avant le témoignage d’Anslinger, un os, sous la forme du médecin Harris Isbell, responsable de la recherche à la prison-hôpital de Lexington. Il est en train d’expliquer que la communauté médicale sait très bien que la marijuana n’est pas une drogue qui crée la dépendance. Elle ne cause ni la mort, ni la folie et, quant aux crimes, « instead of producing criminality, it probably produces passivity».
Anslinger fait un double salto arrière, oublie tout ce qu’il a dit sur la marijuana, et, lorsque vient son tour de témoigner, confirme que le médecin Isbell a parfaitement raison, mais explique que la marijuana est « the certain first step on the road to heroin addiction. » On le croit.
La loi Biggs est adoptée en novembre 1951: sentences minimales de 2 à 5 ans pour possession de cannabis, de cocaïne ou d’opiacés; deuxième offense, de 5 à 10 ans; troisième offense, de 10 à 20 ans. De plus, un juge ne peut plus suspendre une sentence ou accorder une probation dans le cas d’un récidiviste.
Les membres du Congrès peuvent ensuite, l’âme en paix, visionner Terrible Truth, qui explique comment la marijuana conduit directement à l’héroïne.
Terrible Truth (1951 ) (10.03)
Quelques années plus tard, l’OSM, un organisme international chargé d’étudier la santé dans le monde et d’en tirer des conclusions, n’hésite pas à écrire, en 1955, que « Sous l’influence du cannabis, le danger de commettre un meurtre non prémédité est très grand (….) souvent le meurtrier ne connaît pas la victime et tue par plaisir. » L’organisme international n’a pas pensé une seconde aux Marocains ou aux Jamaïcains qui fument de la marijuana ou du kif depuis plusieurs siècles.
Anslinger veut maintenant des peines plus lourdes pour les trafiquants. Il manigance avec Price Daniels du Texas qui a été chargé par le Congrès de réexaminer la loi Harrison à la demande de l’American Bar Association.
Le rapport est remis en janvier 1956. Sept mois, 345 témoins : médecins, policiers, toxicomanes, contrebandiers, etc., pour un total impressionnant de 8 667 pages de témoignages. Tous sont d’accord au moins sur un point. 40 ans après la loi Harrison, «addiction is a growing, not a receding problem… » Les États-Unis ont plus de toxicomanes (60 000) que le reste des nations occidentales combinées.

The Narcotic story (1.14.24)
A Police Science Production (1958)
.
Des lois encore plus sévères
En 1956, le Narcotic Control Act frappe sérieusement: sentence obligatoire de deux à dix ans de pénitencier pour une première offense de trafic, de dix à quarante ans pour une deuxième. Au Canada, la peine maximale pour distribution passe de sept à quatorze ans. (Puis à l’emprisonnement à vie en 1961).
Chaque État peut ajouter sa touche personnelle. Durant la période de 1958 à 1969, en Virginie (et la Virginie n’est PAS exceptionnelle), le crime le plus puni est la possession de drogue, dont la marijuana.
En comparaison:
Meurtre au premier dégré: sentence minimum 15 ans
Viol: sentence minimum de dix ans
Possession de marijuana: sentence minimum 20 ans sans droit de sentence suspendue, de libération sur parole ou de probation
Vente de marijuana: sentence minimum de 40 ans
Les peines pour trafic plongent la Mafia dans une profonde réflexion; les cinq familles de New York importent 90% de la drogue vendue aux États-Unis.
La rencontre de Palerme
Déporté en Italie en février 1946, le parrain Lucky Luciano avait retraversé l’Atlantique dès décembre pour une réunion à la Havane avec les chefs de la Mafia. Parmi les sujets à l’agenda, l’ouverture du premier casino à Las Vegas et la réouverture de la route de l’héroïne. La mafia n’est pas intéressée par les quelques grammes de cocaïne péruvienne qui transitent par Cuba après un détour chez les chimistes chiliens. Comparé à l’héroïne, ce marché semblait sans avenir.
Contrairement au plant de coca qui a ses petits caprices botaniques, le pavot pousse à peu près partout. On en a déjà récolté en Angleterre, au Vermont et même en Colombie-Britannique. Mais il faut environ 250 heures de travail pour récolter un kilo d’opium brut, ce qui limite sa culture aux pays où la main-d’oeuvre ne coûte pas cher.
C’est pourquoi Luciano choisit la Turquie. L’opium brut était ensuite transporté au Liban ou en Syrie, et transformé en morphine-base. L’autre étape, de la morphine à l’héroïne, était un processus particulièrement long et dangereux, qui exigeait un dosage précis et un temps de chauffage exact. Luciano s’était tourné vers les criminels les mieux organisés de France, les Corses. Leurs chimistes transformaient la morphine en héroïne pure à 95% dans des laboratoires clandestins autour de Marseilles, devenue la capitale mondiale de l’héroïne. Les mafiosi assuraient la logistique, le transport, le financement.
Il y avait eu quelques pépins au début: en février 1947, on avait saisi trois kilos d’héroïne apportés par un marin corse arrivé avec le paquebot John Ericsson. Un mois plus tard, le 17 mars, une autre saisie, 13 kilos cette fois, sur le Saint-Tropez arrivé de Marseilles. La mafia avait changé de port; ils utilisaient désormais La Havane et Montréal. Les peines sévères des nouvelles lois américaines risquent de tout changer.
En octobre 1957, les grands responsables de la Mafia sicilienne et américaine se retrouvent à l’Hôtel des Palmes de Palerme.
Conclusion de la réunion, les Américains permettent aux Siciliens moyennant quelques considérations financières de vendre de l’héroïne aux États-Unis.
Les Siciliens s’occuperont de transporter la morphine-base de la Turquie ou du Liban à Marseille, leurs associés corses la raffineront en héroïne, et l’achemineront à Montréal puis aux États-Unis.
En 1960, on saisit à peu près un kilo d’héroïne par année. Il y a entre 50 000 et 120 000 héroïnomanes. Bref la demande est encore faible. Aussi, le plan conjoint des deux Mafias prévoit d’augmenter la demande d’héroïne dans les quartiers ouvriers blancs et noirs en baissant son prix.
Parlant des différents crimes de la Mafia, meurtres, prêts usuraires, extorsion, jeu, Selwyn Raab écrit dans Five Families : «Aucune de ces activités illicites, toutefois, n’a infligé plus de détresse durable à la société américaine et nuit à sa qualité de vie que l’introduction à grande échelle de l’héroïne par la Mafia.»
Drogues: la grande épidémie
En 1960, John Kennedy devient président. Le courant ne passe pas entre lui et Anslinger. D’abord, un scandale de corruption vient d’éclater au Bureau des Narcotiques, ensuite, parce qu’Anslinger dit n’importe quoi. Alors que les Corses et les Siciliens, farouchement anti-communistes, ont commencé à inonder l’Amérique d’héroïne, il déclare que les États-Unis sont en train de gagner la guerre contre la drogue et qu’il faut « tout particulièrement prendre garde à l’utilisation de la drogue comme une arme par les forces communistes (…). »
Signe du climat toxique, le Bureau n’est pas invité lorsque, à la fin septembre 1962, Kennedy convoque une conférence sur les narcotiques. Cinq cents personnes, flics, gouverneurs, psychiatres et spécialistes concluent à un manque abyssal de connaissances sur tout ce qui concerne les narcotiques.
Quelques mois plus tard, Kennedy demande à un groupe de chercheurs de scruter les statistiques compilées par le Bureau des narcotiques. Elles sont tellement peu fiables que les chercheurs les rejettent en bloc. Le Bureau va disparaître quelques années plus tard. En 1962, autre coup dur pour Anslinger. La Cour suprême déclare que la dépendance à la drogue est une maladie et non un crime. La même année, Anslinger est invité à prendre sa retraite. Ironie de l’histoire, vers la fin de sa vie, il utilisera ses contacts pour se procurer de la morphine afin de soulager ses douleurs d’angine.
Kennedy demande de décaper la couche d’ignorance crasse et de désinformation laissée par les décennies de pouvoir d’Anslinger. Il est déjà trop tard. Les jeunes se sont informés tout seuls.
Les Hippies
Les Beatniks ne sont pas nombreux : quelques milliers aux États-Unis, quelques dizaines au Nombril vert à Québec et au café Paloma à Montréal. Mais, habillés de noir, l’air abattu, ils ont le don d’irriter tous les adultes, ce qui est le but de l’exercice. En 1957, on publie enfin «On the Road» de Jack Kérouac, les jeunes se l’arrachent.
Au cours des années qui suivent, des jeunes qu’on va appeler les Hippies et qui s’opposent à la guerre du Vietnam, rejoignent les Beatniks qui ne s’y intéressent pas dans le quartier autour de Haight-Ashbury à San Francisco.
L’Amérique est déjà agacée par leur opposition à la guerre au Vietnam et scandalisée par leur sexualité débridée suite à la découverte de la pilule anriconceptionnelle. Mais avec la drogue, elle est outragée; toutes les idoles des baby-boomers, de Bob Dylan (Everybody must get stoned) aux Rolling Stone en passant par les Beatles (I get high with a little help of my friends) prennent des drogues et recommandent à leurs fans d’en faire autant.
En janvier 1967, Timothy Leary, l’ancien prof d’Harvard et nouveau pape du LSD, lance aux jeunes lors du grand « Human Be-In » à San Francisco, le slogan immortel «Turn on, tune in, drop out ». Mais durant l’été, les speed-freaks débarquent à leur tout à San Francisco.
« Speed kills »
En 1949, les compagnies pharmaceutiques avaient mis sur le marché 1 750 000 comprimés de speeds. Le double dix ans plus tard. En 1962, la Food and Drug Administration (FDA) estime que les Américains consomment 200 millions de pilules d’amphétamines.
Les idoles de la contre-culture, de Timothy Leary à Frank Zappa condamnent le speed. Et quand Frank Zappa condamne une drogue, ça fait réfléchir n’importe qui.
« Speed Kills » peut-on lire dans les journaux undergound comme Berkeley Tribe, East Village, etc.
La consommation baisse. Washington limite la vente des speeds et en 1970, les interdit carrément. Les gangs de motards, déjà gros consommateurs, s’emparent du marché.
Jusqu’alors, une petite minorité de jeunes prenait des drogues; celles-ci sont maintenant soudées à la culture de toute la jeunesse. C’est un des changements culturels les plus dramatiques de l’Occident. C’est particulièrement frappant avec la marijuana. Depuis 25 ans, le Bureau des Narcotiques répètait que la marijuana rendait fou, violent et accrochait les fumeurs dès le premier joint, première étape inévitable vers l’héroïne. C’est peu de dire que les jeunes ne le prennent pas au sérieux. Ils visionnent « Reefer Madness», mais en fumant du pot, pour rigoler… Et c’est parce qu’ils fument du pot qu’ils se font arrêter.
Au Canada, par exemple, le nombre d’arrestations surprend une société qui n’est pas préparée. Depuis la première arrestation pour marijuana en 1937, elles avaient fluctué entre 0 et 12 par année. En 1962, la GRC rapportait 20 cas liés au cannabis. Puis c’est l’explosion : 2 300 cas en 1968 et 12 000 condamnations liées au cannabis en 1972. Aux États-Unis, même tendance lourde.
Le problème est que ces nouveaux usagers ne viennent pas des ghettos mais de la classe moyenne et ils sont instruits. Au Canada, la Commission Le Dain (1969-1973) qui se penche sur la question, critique la peine d’emprisonnement maximale de sept ans pour la culture de cannabis à des fins personnelles.
Selon la loi, ils risquent même d’être emprisonnés à vie pour trafic car celui-ci comprend le « don » ou « l’offre »; on peut donc être accusé de trafic simplement pour avoir échanger « un joint » lors d’une soirée entre amis.
En 1969, Les États-Unis passent une nouvelle loi, la Dangerous Substances Act. Pour la première fois au lieu d’augmenter les peines, on les baisse.
Lors de sa campagne électorale, Richard Nixon avait promis la loi et l’ordre. À peine élu, il lance en septembre 1969 l’« Operation intercept » aussi idiote qu’ambitieuse: fermer la frontière avec le Mexique (2 000 milles de long) pour faire pression sur le gouvernement. Pendant 20 jours, 2 000 douaniers interceptent et fouillent chaque véhicule qui traverse aux États-Unis; 5,5 millions de voyageurs perdent une demi-journée avant de traverser la frontière. Non seulement on ne saisit pas de marijuana mais Nixon et ses conseillers n’ont pas prévu les conséquences d’une disette temporaire.

D’abord, les Colombiens qui vendent un peu de cocaïne aux Cubains de Miami, profitent de la disette et se lancent dans la culture de la marijuana. En attendant, les baby boomers qui cherchent un buzz essaient d’autres drogues.
Dr David Smith, éminent spécialiste en toxicomanie résume: « Le gouvernement a toujours dit que fumer de la marijuana mène à d’autres drogues. En fait, c’est le manque de marijuana qui mène à des drogues plus dangereuses. »
L’historien David Courtwright écrit: «ayant essayé et survécu au fruit défendu du cannabis, les baby boomers étaient ouvertement sceptiques des avertissements officiels sur la cocaïne et les autres drogues.»
La ligne officielle est encore que les vendeurs donnent gratuitement la première dose d’héroïne car ses effets sont si agréables qu’une seule piqûre leur fournit un esclave à vie. C’est tout simplement faux.
Ainsi que le note Richard Ashley, dans son étude Heroin the Myths and the Facts, « il faut deux semaines à une personne, au rythme de deux injections par jour avec un bon produit, pour devenir héroïnomane ». Pour sa part, David Courtwright estime qu’il faut s’injecter, « continuellement, sur une période de temps de 10 à 14 jours. »

.
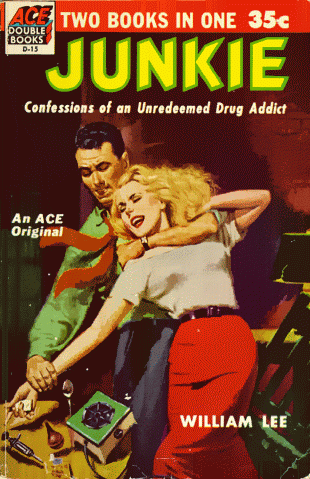
«Addiction is an illness of exposure. By and large those who have access to junk become addicts…»
(William S. Burrough).
Or, des jeunes essaient l’héroïne pour la première fois après avoir vu des amis en prendre eux-mêmes une fois de temps en temps. Ils concluent que le gouvernement a menti sur l’héroïne comme sur tout le reste. Mais, et c’est un gros mais, certains accrochent dès le premier essai. Personne ne peut savoir à l’avance comment il va réagir. Chose certaine, tous accrochent après quelques semaines.
Sister Morphine (Marianne Faithfull)
.
«Ah, come on, sister morphine, you better make up my bed
Cause you know and I know in the morning I’ll be dead
Yeah, and you can sit around, yeah and you can watch all the
Clean white sheets stained red.»
The Pusher ( de drogues dures) (Steppenwolf)
.
«You know I smoked a lot of grass.
Oh Lord! I popped a lot of pills.
But I’ve never touched nothin’
That my spirit couldn’t kill.
You know I’ve seen a lot of people walking ’round
With tombstones in their eyes.
But the pusher don’t care
If you live — or if you die.»
Les conséquences de l’ignorance ne se font pas attendre et sont particulièrement visibles chez les vedettes des jeunes. Jimi Hendrix, Sid Vicious, Janis Joplin, Jim Morrison meurent d’une overdose. Au début des années 1970, entre 600 000 et un million d’Américains prennent régulièrement de l’héroïne.
À New York, elle est la principale cause de mortalité chez les jeunes. L’Amérique s’inquiète; puis elle panique. En mai 1971, le Washington Post révèle que les soldats américains ont pris goût à l’héroïne au Vietnam. L’alcool étant interdit aux jeunes soldats, ils s’étaient tournés vers la marijuana. Les arrestations par la police militaire avaient grimpé considérablement. Les trafiquants s’étaient alors adaptés et avaient offert de l’héroïne provenant du Triangle d’Or, une héroïne tellement pure qu’on peut la fumer.
L’armée prévient le Président Nixon que, chaque jour, 150 soldats héroïnomanes reviennent au pays.
Le 17 juin 1971, Nixon déclare la guerre à la drogue, « l’ennemi public numéro un ». « Le problème a pris les dimensions d’une urgence nationale », dit-il. Mais, pragmatique, Nixon admet que soixante années de répression, de lois sévères et de lourdes peines n’ont pas convaincu les toxicomanes de laisser tomber leur seringue. Les différents traitements non plus. Sauf un, particulièrement inquiétant: il est basé essentiellement sur un narcotique, la méthadone.

À New York, où elle a ouvert un cabinet, l’un des trois qui acceptent des toxicomanes, la psychiatre Marie Nyswander en était venue à la conclusion que la dépendance et les perpétuelles rechutes des toxicomanes n’avaient aucun lien avec leur personnalité ou leurs valeurs morales.
Aussi, comme elle l’écrit en 1956 dans ”The Drug Addict as Patient,” leur faire la morale ou les enfermer est une perte de temps. D’autant plus qu’ils ne sont pas des criminels mais des malades; c’est aux médecins et non aux policiers de s’en occuper.
Nommée présidente d’un comité de recherche sur les narcotiques par la ville de New York, elle rencontre en 1962 le médecin Vincent P. Dole de l’hôpital Rockefeller. Lui aussi croit qu’enfermer les toxicos et les obliger à se passer de drogues mène à la rechute. Spécialiste du métabolisme (biochimie du corps), il a une hypothèse intéressante: la dépendance ne serait-elle pas physiologique? Et il fait à Nyswander une suggestion tout aussi intéressante. Si on essayait la méthadone?

Deux des patients de Nyswander sont volontaires. Les premiers résultats sont prometteurs. Aussitôt au courant, le Bureau des Narcotiques essaie de les intimider; il répand des rumeurs, les espionne et vole même leurs dossiers. Ils résistent, raffinent le dosage, poursuivent leurs expériences, cette fois sur une vingtaine de toxicomanes, ceux qu’Anslinger appelait en 1960 « An immoral vicious social leper », qui rechutent depuis des années.
En 1965, ils publient leurs résultats dans Journal of the American Medical Association: aucun doute, la méthadone est efficace. Elle élimine graduellement, en quelques semaines, sans les douleurs du sevrage, sans effets secondaires, le besoin d’héroine chez les toxicomanes. Plus besoin de seringues; ils avalent la méthadone une fois par jour avec du jus d’orange et ses effets durent toute une journée plutôt que quelques heures. Elle leur permet donc, du moins ceux qui le veulent, de mener une vie normale loin de la prostitution ou du milieu criminel. À ceux qui lui reprochent de substituer une dépendance par une autre, il répond : « Nos patients peuvent travailler et vivre comme des citoyens normaux. La méthadone n’est pas une dépendance, c’est un traitement médical.»
La même année, le psychiatre Jerome Jaffe, qui a travaillé à Lexington, assiste à une conférence de Vincent Dole. Il est soufflé. Pendant six mois, il travaille étroitement avec Dole et en profite pour mieux connaître une nouvelle communauté thérapeuthique, Synanon, qui semble avoir trouvé la clé du succès avec les toxicomanes. Jaffe s’inquiète rapidement des méthodes du fondateur, l’ex-alcoolique Charles Dederich: un mélange curieux d’entraide soutenue comme chez les Alcooliques Anonymes et les Narcotiques Anonymes et de confrontation particulièrement brutale.
Il retient, la confrontation en moins, l’idée de la communauté thérapeuthique. Lorsqu’il retourne à Chicago en 1967, il fonde des cliniques qui combinent méthadone et thérapie. Puis, en mai 1971, il reçoit un appel de la Maison blanche. On lui demande de créer d’autres cliniques à travers l’Amérique.
Pour la première fois depuis la loi Harrison, la majorité du budget de la drogue, jusqu’aux deux tiers, est dépensée pour traiter les toxicomanes plutôt que de les punir; moins de 400 patients traités à la méthadone en 1968, 2 000 en 1969, 73 000 en 1973. Les arrestations liées à la drogue à New York plongent de 40 000 en 1971 à 15 100 en 1973. Beaucoup moins de toxicomanes meurent d’une overdose.
Impressionnée, la commission Le Dain qui enquête sur la drogue au Canada demande d’implanter des cliniques de méthadone au Québec. Réaction immédiate dans la revue de la Canadian Medical Association (mars 1972): « Il n’y a pas de place pour une telle méthode de traitement dans le contexte canadien. » On ouvre quand même quelques cliniques comme aux États-Unis
La Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne n’échappe pas à la vague de contestation, de libération sexuelle et de découvertes des drogues venue de l’Amérique. La différence est qu’un drogué peut s’approvisionner facilement et légalement. Trop peut-être. Au début des années 60, une demi-douzaine de médecins irresponsables prescrivent de l’héroïne au premier venu. À elle seule, Lady Isabella Frankau signe 15% des prescriptions du pays: un jour 900 comprimés d’héroïne à un patient; trois jours plus tard, 600 autres tablettes au même patient. La drogue s’introduit sur le marché noir, et le nombre d’héroïnomanes grimpe de quelques centaines dans les années 50 à quelques milliers au milieu des années 60.
Inquiet, le gouvernement charge un comité de reévaluer les conclusions de Rolleston; elles sont toujours valables: les toxicomanes doivent rester l’affaire des médecins. Mais pour éviter les irresponsables, le comité recommande une mesure draconienne: que les toxicomanes ne soient plus suivis par leurs médecins personnels. Le gouvernement accepte; il va mettre sur pied des cliniques comme aux États-Unis et seuls les médecins de ces cliniques auront le droit de prescrire de l’héroïne ou de la cocaïne sur une base permanente avec consommation sur place. Ce qui veut dire pour les toxicomanes, quelques fois par jour. Les salles d’attente des cliniques débordent. Alors elles remplacent l’héroïne par la méthadone: absorption orale, effet qui dure 24 heures. Un marché noir pour l’héroïne démarre aussitôt.
Aux États-Unis les cliniques d’entretien se développent trop vite et on oublie l’essentiel: la méthadone étant un narcotique, le traitement à la méthadone doit être permanent comme le médecin Dole l’avait bien précisé. Or, on continue à croire qu’il suffit de donner de la méthadone pendant quelques mois seulement et on fait tout pour arrêter ou diminuer les doses. C’est un échec.
Au Québec, les toxicomanes ne sont pas intéressés, les médecins s’y opposent, le fédéral néglige le programme. Les deux lits de l’Hôpital juif ne sont plus disponibles; ceux de la région de Québec n’ont jamais eu de clients; ceux de l’Institut Pinel n’ont été occupés que cinq mois et ceux du Royal Victoria ont été abandonnés.
L’intérêt envers les programmes de méthadone s’estompe d’autant plus que les États-Unis ont trouvé comment régler le problème: couper la production de l’héroïne à la source.

Global War on Heroin | Sep. 4, 1972, Time Magazine
Les Américains, la main sur le robinet de l’aide économique, persuadent la Turquie de limiter la culture du pavot. Puis en 1971, Américains et Français lancent l’offensive. À Marseille, les effets sont spectaculaires: saisies, destruction d’une dizaine de laboratoires, dont celui de Joseph Césari, le génie du mal de la chimie, arrestation de 170 trafiquants, parmi lesquels 50 exportateurs. «La marseillaise», l’héroïne la plus pure au monde, disparaît du marché américain; le kilo d’héroïne passe de 12 000 à 30 000 dollars. On crie victoire.
Les laboratoires de Marseilles sont aussitôt remplacés par ceux de Sicile et de Hong Kong, le terminus de l’opium récolté dans le Triangle d’or, une région située à cheval sur trois pays, la Birmanie, la Thaïlande et le Laos. Dès la fin de l’année 1974, un premier « passeur » chinois est interpellé à l’aéroport de Paris, porteur de quelques kilos d’héroïne provenant du Triangle d’or. Mais les gros fournisseurs des toxicomanes américains sont les Mexicains.
Le Mexique
Bien avant la fermeture de la Turquie, les chimistes de la région de Sinolea acheminaient aux États-Unis le « sucre brun », une héroïne de qualité inférieure mais qu’ils peuvent acheminer sans gros problèmes de l’autre côté de la frontière. Ils fournissent de 70 à 90% du marché américain.
Avec un gouvernement préoccupé par l’héroïne, la marijuana et un vaste choix d’hallucinogènes, la cocaïne qui atttendait dans les coulisses est passée sous le radar. Pourtant, la situation a changé radicalement depuis que Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba en 1959. Les trafiquants se sont réfugiés en Floride et ils ont de nouveaux fournisseurs, des Colombiens qui ont créé des laboratoires tout près de Medellin la deuxième ville du pays.
La cocaïne démarre sur les chapeaux de roues des motos d’Henry Fonda et Dennis Hopper dans la première scène du film populaire Easy Rider (1969). Dans le film, les deux hommes achètent de la cocaïne au Mexique, puis la revendent à un homme qui les attend dans sa Rolls Royce. Les Américains redécouvrent la cocaïne. Dans les années 40, on saisissait autour d’un kilo par année. En 1970, 500 livres. Plus que l’héroïne. Pour la première fois.
Pour Rolling Stone, la cocaïne est la drogue de l’année que l’hebdo Newsweek (27 septembre 1971) décrit ainsi : «The drug, (…) produces feelings of intense sexuality, psychic energy and self confidence.» On ne peut pas dire que c’est dissuasif surtout que tout le monde a oublié qu’elle crée une dépendance.
Mais le « champagne des drogues » (New York Times Magazine, 1974) coûte tellement cher (100$ la grosseur d’un pois – quelques lignes) que seuls les très riches peuvent se l’offrir lors d’occasions spéciales, entrecoupées de longues périodes d’abstinence. Ceux qui s’inquiètent de la dépendance se rassurent en lisant dans Newsweek (30 mai 1977) qu’un « bon nombre de chercheurs ont conclu que la cocaïne est moins dangereuse que l’alcool et les cigarettes quand elle est utilisée avec discrimination. »
Aussi, le gouvernement continue à se concentrer sur la marijuana.
Avec l’accord du Mexique, les États-Unis, en 1975, épandent sur les champs de marijuana un herbicide dangereux, le paraquat. Déjà que la frontière est mieux surveillée, si en plus la marijuana est toxique…
Des amateurs commencent à faire pousser de la marijuana en Californie, à Hawaï, en Colombie-Britannique et au Québec. On ne connaît alors qu’une variété, le Cannabis sativa, qui ne résiste pas au gel. On cherche frénétiquement d’autres variétés et à la fin des années 70, commence à pousser ici le cannabis indica, cultivé depuis des siècles en Afghanistan.
Décriminaliser la marijuana?
Pendant cette quête du graal botanique, beaucoup espèrent que fumer du pot va cesser d’être un acte criminel. Le Parti libéral veut modifier, en 1972, la loi sur la marijuana. Quatre ans plus tard, le candidat à la présidence Jimmy Carter s’engage à la décriminaliser. En 1978, le chef du Parti progressiste-conservateur, Joe Clark, déclare qu’il décriminalisera la simple possession aussitôt élu. Ce ne sera plus un crime, on paiera une amende, comme pour une effraction routière. Puis Ronald Reagan est élu Président. Retour à la ligne dure, d’autant plus que la cocaïne fait maintenant blip sur tous les radars.
«When I have a line of coke
I feel like a new man
And the first thing that new man wants
is a line of coke.»
(Un cocaïnomane)
Les Colombiens commencent à acheter les quatre récoltes annuelles de coca directement de la Bolivie et du Pérou et grâce au général Pinochet du Chili, la raffinent. Le dictateur, à la demande des Américains, a extradé en 1973 des trafiquants chiliens aux États-Unis. Les chimistes ont alors offert leurs services aux Colombiens.

Leurs passeurs apportent maintenant de la cocaïne, en plus de la marijuana, aux Cubains de Floride. Moins de place dans les bagages, aucune odeur et plus de profits. Elle est de plus en plus disponible mais encore très dispendieuse. Plus pour longtemps. La rencontre en prison de deux étrangers va tout changer.
Dès les années soixante, George Jung transportait avec son propre avion de la marijuana de la Colombie. Lorsqu’il est arrêté il ne sait encore rien sur la cocaïne. Mais son compagnon de cellule, le Colombien Carlos Lehder, est associé aux criminels qui formeront le cartel de Medellin. Il fait son éducation avec plaisir, soulignant les avantages financiers et le peu de poids de la cocaïne.
La maison de Carlos Lehder’s à Norman’s Cay (4:35)
.
Dès leur libération, Lehder jette son dévolu sur une des 700 îles des Bahamas, la minuscule Norman’s Cay, à 210 miles de la Floride. Il révolutionne le transport de cocaïne en utilisant une flotte d’avions: gros porteurs de la Colombie aux Bahamas, petits bimoteurs pour le reste du trajet vers la Floride. « Dans les années soixante-dix, 90 % de la cocaïne aux États-Unis était fournie par moi », dira plus tard George Jung.
(Johnny Depp interprète Jung dans le film «Blow», en 2001).
Les Colombiens contrôlent maintenant la production et le transport. Ils veulent aussi la distribution alors dans les mains des Cubains de Floride. Les Colombiens leur déclarent la guerre. Elle est sanglante. Un meurtre par jour. Dade County est obligé de louer des camions réfrigérés.

Les Cubains écartés, des immigrants colombiens gèrent le flot de cocaïne; vers 1980, 80 avions atterrissent en Floride chaque nuit. En 1981 par exemple, les Ochoa, plus Escobar et Lehder et le cartel de Medellin introduisent 19 tonnes de cocaïne aux État-Unis. Les prix baissent.
Puis, à Miami, à Los Angeles, des policiers, perplexes, remarquent lors de perquisitions, des pipes en verre, des canettes avec des trous. À quoi cela peut-il servir? Puis, ils comprennent : quelqu’un a découvert comment fumer la cocaïne.
Il y a de quoi être surpris; très sensible à la chaleur, la cocaïne se décompose avant d’atteindre la température nécessaire pour se changer en vapeur. Pour la fumer, il faut la changer chimiquement; en gros il faut libérer (free) la base en vapeur (free basing).
Les freebasers essaient toutes sortes de produits chimiques, tels que l’ammoniaque et l’éther. Hautement dangereux. La revue Rolling Stone titre en avril 1980 : « Freebase: A treacherous obsession ». Même High Times, la Bible accomodante des amateurs de drogues, s’inquiète: « Can You Smoke Without Beeing Burned? » En 1981, le comédien Richard Pryor prouve la pertinence de la question; il est gravement brûlé.
Puis quelqu’un découvre l’alkali parfait, inoffensif, disponible dans tous les dépanneurs, le bicarbonate de soude.
À 100$ le gramme (une cuillère à thé), la cocaïne est encore une drogue de luxe. Le même gramme, transformé en 5 à 30 morceaux qui se vendent à l’unité 2$, 5$, 10$, 20$, fait basculer le marché de la cocaïne; le champagne de la drogue devient le Big Mac des drogues de rue qu’on vend sous différents noms, Ready Rock en Floride par exemple.
Puis le 17 novembre 1985, le New York Times publie un article qui ameute l’Amérique, des jeunes fument « une nouvelle forme de drogue appelée crack. »
En fait, seul le nom est nouveau. Mais il est magique. La presse se déchaîne. Les articles se concurrencent à grands coups de superlatifs et c’est à qui fera le plus peur au monde. On prédit une épidémie de « la drogue la plus puissante jamais vue. »
Le baron du crack Freeway Ricky Ross (26.31)
.
Les « crack babies »
En 1986 on en parle partout. Les journalistes ont déformé un article du Dr. Ira Chasnoff dans le New England Journal of Medicine paru l’automne précédent qui semblait dire que les femmes enceintes qui fumaient du crack hypothécaient le futur développement de l’enfant: les « crack babies » viennent de naître. Durant l’année, Time et Newsweek affichent en couverture, chacun à cinq reprises, le problème du crack. Et des crack babies. Or, il n’y a pas de crack en dehors de Miami, Los Angeles et New York. La même année, deux vedettes sportives, Len Bias (basketball) et Don Rogers meurent d’une overdose de cocaïne. On accuse le crack.
Une loi est votée à la vapeur: cinq ans minimum pour possession de 5 grammes de crack. En poudre, il faut 500 grammes pour avoir la même sentence. On crie à la discrimination.
Le 27 octobre 1986, Ronald Reagan signe la National Security Directive 221.
Cette fois c’est la guerre, la vraie, sur stéroïde. Il mobilise le FBI, les services secrets, de la CIA à la NSA, et les forces armées. Avec le dernier cri de la quincaillerie militaire: avions de surveillance de la marine, hélicoptères de combat, aérostats pour surveiller les Caraïbes et intercepter la cocaïne avant son arrivée en Floride. On réussit.
Aussitôt la cocaïne passe par l’Amérique centrale. Les Colombiens ont acheté Manuel Noriega, le dictateur du Panama; les cartels mexicains, Raul Salinas, le frère du futur président du Mexique.
Pablo Escobar, baron de la drogue ( 46.17)
.
Fin de la Colombie
En 1987, Carlos Lehder est capturé près de Medellin, extradé aux États-Unis et condamné à 135 années de prison. En décembre 1989, invoquant la lutte contre la drogue, le Président Bush envahit le Panama et arrête le dictateur Noriega. En décembre 1993, Pablo Escobar est abattu par la police.
A Washington, au quartier général de l’Office of National Drug Control Policy, trône un poster avec les photographies des 16 chefs des cartels de l’Amérique latine. Un employé trace un X sur celui d’Escobar.
Trois ans plus tard, sur le poster, 16 X rouges: tués, extradés, en fuite. En 1996, des leaders du cartel de Cali se rendent à Guadalajara pour rencontrer les trafiquants mexicains. Les Colombiens leur abandonnent la distribution; ils vont désormais envoyer la coca et l’héroïne par bateau à Guadalajara, et laisser les Mexicains se charger de l’introduire aux États-Unis et de la distribuer. C’est le début des gros cartels mexicains.
Pendant que les Américains ont les yeux rivés sur la frontière mexicaine, une nouvelle drogue se propage discrètement, grâce à un livre de cuisine, au coeur de leur pays, dans les États agricoles du Mid-Ouest.
Le livre d’un indigné
Décriés puis oubliés, les speeds connaissent une renaissance dans les années 1980 lorsque des gangs de motards apprennent, entre deux explosions de labos clandestins, à fabriquer une forme de speed qu’on peut fumer, et qui crée une dépendance très rapidement : le cristal méthamphetamine (Crystal Meth).
Le problème ne touche longtemps que la Côte ouest parce que très peu de personnes savent comment fabriquer ces cristaux. Un indigné va tout changer. Au milieu des années 1980, un chimiste du Wisconsin, Steve Preisler, qui n’en revient pas d’être emprisonné pour quelques grammes d’amphétamine, emprunte la machine à écrire d’un détenu et, sous le nom de plume « Uncle Fester », publie « Secrets of Methamphetamine Manufacture ».
On y trouve six différentes recettes faciles pour préparer la drogue avec des ingrédients légaux.

Pendant que les cuisiniers amateurs créent des laboratoires dans le Middle West et parfois sautent avec eux, la Californie s’attaque aux labs clandestins. Les cartels mexicains se dépêchent de produire du cristal et, dès 1994, l’ajoutent, avec la cocaïne, à leur palette de produits. Ils disent à leurs acheteurs: « Essayez-ça. L’effet est semblable. » Plutôt que de se faire la guerre, les cartels s’entendent avec les gangs de motards pour la distribution.
La même année, Eric Stolz dit à John Travolta dans le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino: « Coke is as dead as dead. Heroin is coming back in a big fucking way ». Il a raison à moitié: la cocaïne n’est pas morte.

Pulp Fiction (1994)
Le réveil des personnalités
En 1998, des centaines de personnalités, l’ancien Sécrétaire Général de l’Onu Javier Perez de Cuellar, l’ancien Sécrétaire d’État George Shultz, le journaliste américain le plus respecté, Walter Cronkite, des prix Nobel, publient dans le New York Times une lettre ouverte au Sécrétaire Général Kofi Annan. « We believe that the global war on drugs is now causing more harm than drug abuse itself. » La lettre conclut: « realistic proposals to reduce drug-related crime, disease and death are abandoned in favor of rhetorical proposals to create drug-free societies. »
L’ONU n’en tient pas compte; elle vit dans une autre galaxie. Quelques jours plus tard, elle annonce qu’en 2008, on aura considérablement réduit la culture d’opium, de cannabis et de coca dans le monde et donc la consommation de drogues.
En 2008, dix ans après la déclaration de l’ONU, on ne pouvait pas dire que le monde était libéré des drogues illicites; aujourd’hui non plus. Un seul exemple: les exportations marocaines de résine de cannabis s’élèveraient à 13,5 milliards de dollars par an.
Depuis 2006, 50 000 Mexicains ont perdu la vie à cause de la guerre à la drogue. Les revenus bruts des cartels mexicains tournent autour de six milliards de dollards et ils ont maintenant leurs antennes dans 230 villes américaines.
Il y a trois ans, on a démantelé un super-cartel colombien; il exportait une centaine de tonnes par année et comptait sur un millier de labos clandestins en Colombie.
De nouveaux liens se forgent depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe, en passant par l’Afrique de l’Ouest. Un tiers de la cocaïne en Europe passe par la Guinée-Bissau, un autre Narco-État .
Fermer les frontières
Il est impossible d’avoir une frontière étanche même dans les états policiers, alors dans une démocratie… Comme le résumait le directeur d’un pénitencier: « la drogue entre dans les pénitenciers supermax et on serait capable de l’empêcher de franchir une frontière? »
Même si c’était possible, les drogues de synthèse, les speeds, la marijuana, sont maintenant des produits tout à fait locaux.
Tous les efforts du D.E.A., de la GRC et de la S.Q pour éradiquer les champs de marijuana (surveillance aérienne, analyse de cartes) ont tout simplement incité les cultivateurs à se recycler dans la culture hydroponique et, pour que ce soit rentable, à créer des plants de plus en plus puissants. À la fin des années 90, ils fournissaient 29% du pot consommé aux États-Unis; autour de la moitié aujourd’hui. Parmi le 50% qui vient d’ailleurs, une partie vient du Québec et de la Colombie britannique. Quant aux speeds, les Américains ont fermé 7 530 labos de métamphétamines en 2009; 11 000 une année plus tard, dont 2 000 dans l’État agricole de l’Iowa. Le Québec pour sa part est autosuffisant en speeds et en drogues de synthèse.
«Personne n’a encore fait la preuve que la ligne dure pourra un jour gagner la guerre contre la drogue. Elle peut faire une différence, endiguer le trafic mais elle ne gagnera jamais la guerre contre les drogues, c’est-à-dire les empêcher d’être disponibles. C’est le but de la ligne dure, et c’est un but inatteignable. » Robert Stutman ex-responsable du DEA pour la ville de New York.
Mais ce ne sont plus seulement quelques personnalités prestigieuses qui décrochent. Aujourd’hui, beaucoup de pays refusent de suivre l’ONU et les États-Unis dans sa guerre contre la drogue. Aux réunions annuelles de la Commission des stupéfiants de l’ONU, les débats sont de plus en plus houleux. En 2009, Evo Morales, le président bolivien, crée un scandale : il mâche une feuille de coca en pleine réunion de la Commission.
Douce vengeance que les Boliviens ruminaient depuis qu’en 1961, l’ONU avait donné 25 ans à la Bolivie et au Pérou pour éliminer les plantes de coca.
Avec 5 000 ans d’expérience derrière eux, les Boliviens font la différence entre mâcher de la coca (l’équivalent de boire une couple d’espressos) et s’injecter de la cocaïne dans les veines. Dans une feuille de coca, 0,5% du contenu chimique est de la cocaïne. Un mâcheur passe à travers 30 grammes de feuille par jour soit 150 miligrammes, ou une ligne moyenne de coke.
Morales déclare: « La feuille de coca n’est pas la cocaïne, nous devons en finir avec cette confusion ». Il demande son retrait de la liste des substances interdites tout en demandant qu’y soit inclue la pâte de cocaïne qui n’y figure pas. Refus. En 2012, la Bolivie se retire de la Convention des Nations unies sur les stupéfiants. Un an plus tard, les Nations unies appuient majoritairement la culture, le commerce et la possession de feuilles de coca sur tout le territoire de ce pays d’Amérique latine. Le Canada vote contre.
En février 2009, trois ex-présidents, celui du Mexique, de la Colombie et du Brésil, ont signé un document capital:
«La guerre contre les drogues a échoué. (…) Il est grand temps de remplacer une stratégie ineffective par des politiques sur la drogue plus humaines et plus efficaces.» (…)
D’autres politiciens latinos ont demandé en 2011 qu’on repense toute la question de la guerre.
De plus en plus de pays n’attendent pas l’accord de l’Onu ou des États-Unis.
La légalisation?
Les Hollandais ont le droit de posséder de petites quantités de drogues douces : marijuana, champignons magiques, etc. Les Portugais depuis 2001, les Mexicains depuis 2009, peuvent aussi posséder de petites quantités de cocaïne et d’héroïne. Mais la vente reste interdite parce que la légalisation est un panier de crabes bien résumé par Loan Grillo : « So we get into that toxic, contentious, prohibited, muddled, and crucially needed argument- the legalization debate » ( El Narco P. 276). Aujourd’hui encore,
personne ne peut répondre aux deux questions essentielles: combien de personnes essaieraient des drogues si elles étaient légales et, parmi elles, combien y aurait-il de nouveaux habitués?
Après avoir signalé que la légalisation ne voudra surtout pas dire qu’on ne pourra pas vendre n’importe quelle drogue à n’importe qui, David T. Courtwright pose dans la revue American Heritage une question embarrassante:
“If drugs are legalized, but not for those under twenty-one, or for public-safety officers, or transport workers, or military personnel, or pregnant women, or prisoners, or probationers, or parolees, or psychotics, or any of several other special groups one could plausibly name, then just exactly who is going to buy them? Noncriminal adults, whose drug use is comparatively low to begin with?
It would be more accurate to ask whether society should risk an unknown but possibly substantial increase in drug abuse and addiction in order to bring about an unknown reduction in illicit trafficking and other costs of drug prohibition.” (American Heritage, Février-Mars 1993)
En attendant, plusieurs pays ont décidé de limiter les dégâts des toxicomanes en les traitant comme des malades et non comme des criminels.
The Truce On Drugs
What happens now that the war has failed?
(By Benjamin Wallace-Wells, Published Nov 25, 2012, New-York Magazine)
Limiter les dommages (ou la réduction des méfaits)
Pour les traiter comme des malades, il faut d’abord admettre qu’il n’y a pas de cure facile pour les drogues dures.
Qu’à l’origine la toxicomanie soit causée par le vice, le manque de volonté et de motivation, comme on le croyait au début, des problèmes de personnalité comme on l’a cru longtemps, des causes sociales selon les sociologues, des causes psychologiques et sociales comme le pensent les communautés thérapeutiques (Daytop, Synanon, Phoenix house, Portage, etc.) ou encore d’un mélange toxique de biochimie et de mauvaises conditions sociales comme on le croit de plus en plus, ça ne change abolument rien au résultat: il est trè très difficile de perdre l’habitude de drogues comme l’héroïne.
Les politiciens auraient pu refuser cette évidence et garder leur tête dans son habitat naturel, un trou dans le sable. Ils en ont été empêchés par le sida et ses coûts faramineux qui plombent les revenus des États. Au Québec, par exemple, une trithérapie pour le VIH coûte au moins 15 000 $ par année au ministère de la Santé.
En dehors de l’Afrique, le sida se propage essentiellement à cause des seringues infectées, la voie royale vers l’infection: 83% des cas en Russie, 44% en Chine, 25% aux États-Unis. C’est que les toxicomanes ne se transmettent pas seulement le VIH entre eux; ils ont évidemment d’autres partenaires sexuels et c’est ainsi qu’ils le transmettent dans le reste de la population.
À la fin des années 1970, le Révérend Hans Visser se rendait à l’église Saint-Paul à Rotterdam. Il voit un itinérant qui ramasse l’eau d’une flaque pour sa prochaine injection. Visser lui offre de venir à l’église, où il trouvera de l’eau propre. C’est le début de son implication. Il aménage à l’église un local pour les toxicomanes. Puis réalisant qu’ils prèfèrent s’injecter avec des seringues stériles, Visser en trouve et les échange contre leurs seringues infectées qui disparaissent des lieux publics. La mairie, la police, l’appuient discrètement. C’est la première façon de limiter les dégâts.
Une dizaine d’années plus tard, des médecins montréalais distribuent des seringues dans les rues de la métropole. Le médecin Jean Robert de l’hôpital Saint-Luc demande la création de centres d’échanges de seringues.
Les premiers centres voient le jour en 1987 à Toronto, puis à Vancouver et Montréal en 1989. Pour beaucoup de toxicomanes, c’est, en dehors des urgences, leur premier contact sérieux avec le milieu de la santé et le seul endroit où on les incite à passer des tests de VIH.
Des politiciens s’indignent: c’est cautionner le vice. En 1988, le Congrès interdit que l’argent du fédéral finance ce genre d’endroits. Depuis, le Président Clinton a supporté l’idée, mais en prenant bien soin de ne pas lever l’interdiction. Quant à Bush …
S’injecter en paix
À Rotterdam, le pasteur Visser a vite réalisé que, les seringues échangées, les toxicomanes allaient ensuite s’injecter comme d’habitude un peu partout: les parcs, les toilettes publiques, etc. Il ouvre alors un centre d’injection supervisée (CIS). À peu près au même moment, à Berne, en Suisse, les propriétaires d’un café qui acceptait les clients toximanes rejetés partout ailleurs vont discuter avec la police et la ville d’un problème inattendu: leurs clients ont commencé à s’injecter sur place.
Pesant le pour et le contre, les autorités décident que le café va devenir un centre d’injections supervisées. Comme à Rotterdam, les toxicomanes cessent de s’injecter à la vue de tous et les seringues ne se retrouvent plus dans les terrains de jeux ou les parcs publics. Durant les années 1990, d’autres centres émergent ailleurs en Suisse, en Allemagne en Hollande.
Pendant ce temps au Canada
En 1988, il y avait eu 18 overdoses mortelles à Vancouver; cinq ans plus tard, 200. En 1997, le Bureau de la Santé lance l’alarme, le tiers des toxicomanes de la ville sont porteurs du VIH (90% souffrent d’hépatite C), le plus haut taux d’infection en Occident.
Inspiré par les exemples de Rotterdam et de Berne, la ville de Vancouver obtient du gouvernement libéral une exception temporaire de la loi fédérale sur les drogues et ouvre en 2003 Insite, la première clinique d’injection en Amérique du Nord.
Quelques années passent. Insite, comme les autres cliniques dans le monde, ne fournit pas seulement des seringues propres, mais aussi du personnel médical. Ce qui n’empêche pas les surdoses (il y en a eu quelque 2 400), mais évite qu’elles soient fatales. On épargne des vies, des transports par ambulances, des chambres d’hôpitaux. Et on établit un climat de confiance qui augmente la demande pour les cures de désintox.
Insite est appuyé par la ville, la province et la police de Vancouver. La GRC est l’exception. Fait inouï, elle commande deux recherches sur Insite. Déception! Elles sont favorables à Insite. La GRC en commande alors deux autres dont une, pour éviter les mauvaises surprises, à une organisation opposée à Insite. Cette fois, la GRC obtient les résultats attendus et les achemine à Tony Clement, ministre de la Santé du nouveau gouvernement conservateur et qui considère Insite comme une « abomination ».
RCMP and the truth about safe injection sites (by John Geddes on Friday, August 20, Macleans)
Lors de la réunion annuelle de l’Association Médicale Canadienne en 2007, le ministre blâme les médecins de supporter Insite. Clement dit « que les universitaires débattent encore » de la pertinence des centres d’injections et fait allusion à de nouvelles études qui mettent en doute les recherches déjà faites. En clair, d’un côté une étude non vérifiée par des pairs universitaires et commandée par la GRC et de l’autre, une trentaine d’articles universitaires, dont les gros canons de la médecine : le New England Journal of Medicine aux États-Uniset The Lancet en Grande-Bretagne, qui ont publié des conclusions massivement positives.

Tony Clement nomme ensuite son propre comité d’experts pour reviser la recherche. On ne peut plus se fier à personne : le comité rapporte en avril 2008 que l’expérience est positive. Malgré cela, le ministre ne veut pas renouveler l’exemption au-dela de l’été, ce qui veut dire fermer le centre.
Insite va en cour. Obient une prolongation. Ottawa va en appel. Perd et porte alors la cause devant la Cour suprême du Canada. Finalement, le 30 septembre 2011, la Cour suprême se prononce. Le plus haut tribunal du pays déclare qu’Insite sauve des vies, qu’elle a eu un effet bénéfique sur la santé, sans provoquer une hausse des méfaits liés à la consommation de drogues et à la criminalité dans les environs.
Le Dr Alain Vadeboncoeur résumait récemment les dix ans d’histoire d’Insite à l’émission Médium Large.
Un mois après les grandes déceptions du ministre, le Programme national de santé publique annonce que le Québec aura ses cliniques d’injections en 2012. À Montréal, 19 % des UDI sont porteurs du VIH, et 68 % ont contracté l’hépatite C. À Québec, 11 % des UDI ont le VIH, et 64 % l’hépatite C. Puis, changement de ministre. Le nouveau titulaire Yves Bolduc, qui a oublié sa colonne vertébrale dans son ancien bureau, annonce en août 2008 qu’il n’y aura pas de cliniques parce qu’il n’y a pas assez de preuves scientifiques concluantes sur leur l’efficacité….
Yves Bolduc a rejeté les conclusions de revues scientifiques comme The Lancet, et les opinions de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) et l’Ordre des infirmières du Québec. Incidemment, une majorité de Québécois (quelque 60% appuient les sites d’injection supervisée).
Il n’a consulté ni la douzaine de cliniques d’injection suisses, ni la soixantaine de cliniques dans le monde, notamment aux Pays-Bas, en Australie, à Vancouver, au Luxembourg, en Norvège et en Espagne et certaines avec vingt ans d’expérience. Même un organisme aussi prudent que l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) a été obligé d’avouer que ” all the key objectives of these rooms have been achieved. According to available research, the evidence suggests that the benefits of consumption rooms can outweigh the risks. » Non, Bolduc attend un rapport interne d’un Comité-conseil sur la prévention du VIH et du VHC chez ceux qui prennent des drogues. Bolduc le reçoit en mai 2009. Bolduc le lit, s’assoit aussitôt dessus et le couve nerveusement. Un an plus tard, on apprend que le rapport recommande, noir sur blanc, l’ouverture de centres d’injections supervisés. Dans d’autres pays mieux dirigés, non seulement il y a des cliniques d’injections, mais elles offrent de la méthadone.
Alors, Bolduc se replie sur la consultation, le dernier refuge du velléitaire: avant d’ouvrir des cliniques, il faudra consulter la population, les autorités municipales, les corps de police et les centres de santé et de services sociaux, entre autres… (remarquons la saveur de “entre autres”) Bref, la semaine des quatre jeudis. En juin 2013, le gouvernement conservateur annonce sensiblement la même vaste consultation. Dans d’autres pays mieux dirigés, non seulement il y a des cliniques d’injections, mais elles offfrent de la méthadone.
Fournir la méthadone?
Commencés dès les années 1970 en Hollande, les programmes de méthadone se sont répandues en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne etc. Tous ces pays ont compris ce qu’écrivaient il y a près de vingt ans Ethan Nadelmann et Jennifer McNeely :
« Vous pensez que la dépendance est une maladie? Alors la méthadone est l’équivalent de l’insuline. Vous pensez que la dépendance est une mauvaise habitude? Alors la méthadone est aux héroïnomanes ce que les patchs de nicotine sont aux cigarettes. (…) La meilleure façon d’éliminer le marché illicite (..) est de rendre la méthadone aussi disponible que possible à n’importe quel héroïnomane. Il n’y a en réalité aucun inconvénient, que des bénéfices. » (The Public Interest, Spring 1996, p.83)
De son côté, l’Institute of Medicine américain conclut: « La politique actuelle (…) met trop l’accent sur la protection de la société contre la méthadone et pas assez pour pour protéger la société comme les épidémies de dépendance, de violence, de maladies infectueuses que la méthadone peut aider à réduire. » (Federal Regulation of Methadone Treatment, Institute of Medicine; Richard A. Rettig and Adam Yarmolinsky, Editors; Committee on Federal Regulation of Methadone Treatment.)
De plus, en Belgique et en Allemagne, les médecins prescrivent la méthadone directement à leurs patients. Un bémol: la méthadone n’a aucun effet sur les cocaïnomanes, ça ne marche tout simplement pas.
Ou l’héroïne?
À Zurich, les Suisses avaient tenté une autre tactique avec les toxicomanes: laisser faire.


Needle Park
Après avoir essayé pendant des années de chasser les héroïnomanes d’un parc de Zurich, la ville décide en 1987 de les laisser faire. Pas de police, pas d’arrestations. Un tsunami de toxicomanes venus de toute l’Europe déferle sur « Platzspitz », le Parc de l’aiguille. Chaque jour, c’est la guerre entre vendeurs pour fournir les 4 000 toxicomanes qui s’approvisionnent dans le superbe parc jonché de seringues. Des images de toxicomanes en train de s’injecter font le tour de la planète. Les services d’urgence sont débordés par les overdoses, la police par les vols et les cambriolages. Le gouvernement ferme le parc en 1992. Mais que faire avec les toxicomanes? Les Suisses vont voir ce qui se passe à l’ « addiction clinic » de Liverpool, la ville où l’héroïne est tellement abondante qu’elle est surnommée « smack city ».
Depuis la fin des années 60, les médecins britanniques avaient cessé de prescrire de l’héroïne. Ils avaient été remplacés par quelques cliniques qui n’offraient que la méthadone. Les toxicomanes qui ne voulaient pas se déplacer ou qui préféraient l’héroïne s’étaient tournés vers le marché noir qui importait de l’Afghanistan et le Pakistan. Les cas de sida avaient grimpé en flèche. Mais à Liverpool, le psychiatre John Marks prescrivait avec succès de l’héroïne depuis des années à son « addiction clinic ». Les Suisses décident de copier le modèle.
En 1994, la Suisse fait un essai : donner gratuitement des doses d’héroïne. L’essai minutieusement surveillé dure des années avec des résultats concluants. Lors d’un référendum en 2008, 68% des Suisses approuvent la mesure. Le succès des Suisses encourage les Allemands, les Hollandais à essayer leurs propres programmes de prescription de l’héroïne.
En conséquence, les toxicomanes ont nettement moins de contact avec les dealers, ce qui joue un rôle sur la criminalité. De plus, l’héroïne distribuée est pure. S’injecter soi-même dans les veines est une activité dangereuse. Quand on dit que l’héroïne est pure à 10%, cela veut dire que les toxicomanes vont s’injecter 90% de produits étrangers. Il n’est pas nécessaire d’être un expert de la santé pour deviner que ce n’est pas sain.
Est-ce que le modèle hollandais, suisse ou allemand fonctionnerait ici? Peut-être pas. Mais, chose certaine, le modèle canadien ne fonctionne pas pour le Canada.
À Vancouver et Montréal, entre 2005 et 2008, on a expérimenté la prescription d’héroïne: le programme N.A.O.M.I. (North American Opiate Medication Initiative). La premiè re et seule en Amérique du Nord. Entourés d’infirmières, de médecins et de travailleurs sociaux, les toxicomanes se présentaient quotidiennement à la clinique, pour recevoir leur dose et leur seringue propre. Les résultats ont été positifs : diminution de l’usage illicite d’héroïne de près de 70%; le pourcentage de participants impliqués dans des activités illégales a diminué de la moitié (passant de 70% à 36%); le montant dépensé en drogues avait diminué de près de moitié, passant en moyenne de 1 500 $ par mois, à 300$ ou 500$ par mois. Sans grande surprise, le ministère de la santé et des services sociaux de l’époque n’a pas voulu financer la phase 2 de l’expérience au Québec :
Recherche – SALOME se fait couper les vivres
Marco Bélair-Cirino, Le Devoir , 20 août 2009
La dangereuse ignorance
Anslinger a toujours dit: « La plupart des jeunes acquièrent ces mauvaises habitudes non pas à cause de l’ignorance, mais parce qu’ils en savent trop ». En 1955, le Comité spécial du Sénat sur le trafic de stupéfiants au Canada avait rejeté l’idée de campagnes nationales d’éducation auprès de la population en général et des adolescents en particuliers, parce qu’ils : « peuvent éveiller une curiosité indue chez les jeunes. »
En 1972, la criminologue Marie-Andrée Bertrand de la commission Le Dain insistait sur la nécessité d’une meilleure information sur les drogues. Quelques décennies plus tard, PBS a demandé à Robert Stutman, ex-responsable du DEA pour la ville de New York, ce qui serait efficace dans la lutte contre les drogues: « Des études ont montré que si on donne à chaque enfant américain, en commençant à la maternelle, des leçons obligatoires, sérieuses sur l’abus des drogues, 15% de moins vont expérimenter les drogues lorsqu’ils entrent en 10e année. Ça ne fait pas gagner la partie, parce qu’il est impossible d’empêcher tout le monde de prendre des drogues, mais l’effet est plus notable que tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant. »
Un auteur a fait la comparaison avec les grossesses non désirées. Malgré l’éducation sexuelle dans toutes les classes et les contraceptifs disponibles partout, des filles tombent encore enceintes. Mais il y en a moins.
Depuis la première incision de la capsule verte du pavot, des individus ont pris des drogues, qu’elles soient interdites ou non, pour toutes sortes de raisons: pour échapper à la douleur, aux fardeaux de la vie, pour l’aventure, pour s’amuser. Donnant l’exemple de la cocaïne, Dominic Streatfeild écrivait:
« À la racine du problème de la cocaïne est le fait que les gens prennent des drogues pour agacer leur cerveau (to mess with their brains), parce que c’est amusant. » Cocaine: An Unauthorized Biography p. 489
Ça ne changera pas demain, ni après-demain.
En 1979, le médecin Kenneth Walker, chroniqueur sous le pseudonyme de W. Gifford-Jones MD, publié dans 65 journaux, était scandalisé par les soufrances des patients en phase terminale. Dans une chronique, il affirme que ces agonisants devraient avoir droit à l’héroïne. 30 000 lettres ont suivies, toutes favorables, obligeant pratiquement le fédéral à créer un comité de 10 médecins sur le sujet. Après étude, le comité et des organisations représentant les pharmaciens s’opposent à donner de l’héroïne à ces patients à la veille de mourir. Parmi leurs soucis, le danger qu’ils deviennent héroïnomanes…
– –
Autres articles de la série «Petite histoire de…» publiés dans le Kiosque
Petite histoire des Inuit, de leur arrivée en Amérique à aujourd’hui
Petite histoire de la Mafia et du crime organisé en Amérique
Les Hommes en noir : les Hassidim
Petite histoire de : La réforme scolaire: né pour un petit bulletin
Petite histoire des Noirs du Québec
Petite histoire de : L’indéchiffrable manuscrit
Petite histoire des entités et autres esprits : Le médium et le message
Petite histoire des Indiens d’Amérique : Le Printemps indien
Petite histoire de Joseph Jean, l’étrange Ukrainien
Petite histoire des camarades québécois
Petite histoire de : L’aventure chrétienne
Petite histoire de l’insaisissable trésor de l’Ile-aux-Chênes
Petite histoire des lépreux de l’Acadie
Petite histoire des Robin: exploiter les Gaspésiens jusqu’à la dernière morue
Petite histoire des Canadiens français dans la Résistance :
« Et maintenant, mettez le feu à l’Europe ! » (Winston Churchill) (partie 1)
Des agents canadiens français dans la Résistance (partie 2)
Les Anonymes: Petite histoire des groupes anonymes
Petite histoire de la forêt québécoise
Petite histoire de la Bataille du Saint-Laurent, la victoire oubliée
Petite histoire des trésors polonais cachés au Québec : l’étrange cavale
Petite histoire du miracle médical de la petite fenêtre sur l’estomac d’Alexis Saint Martin









